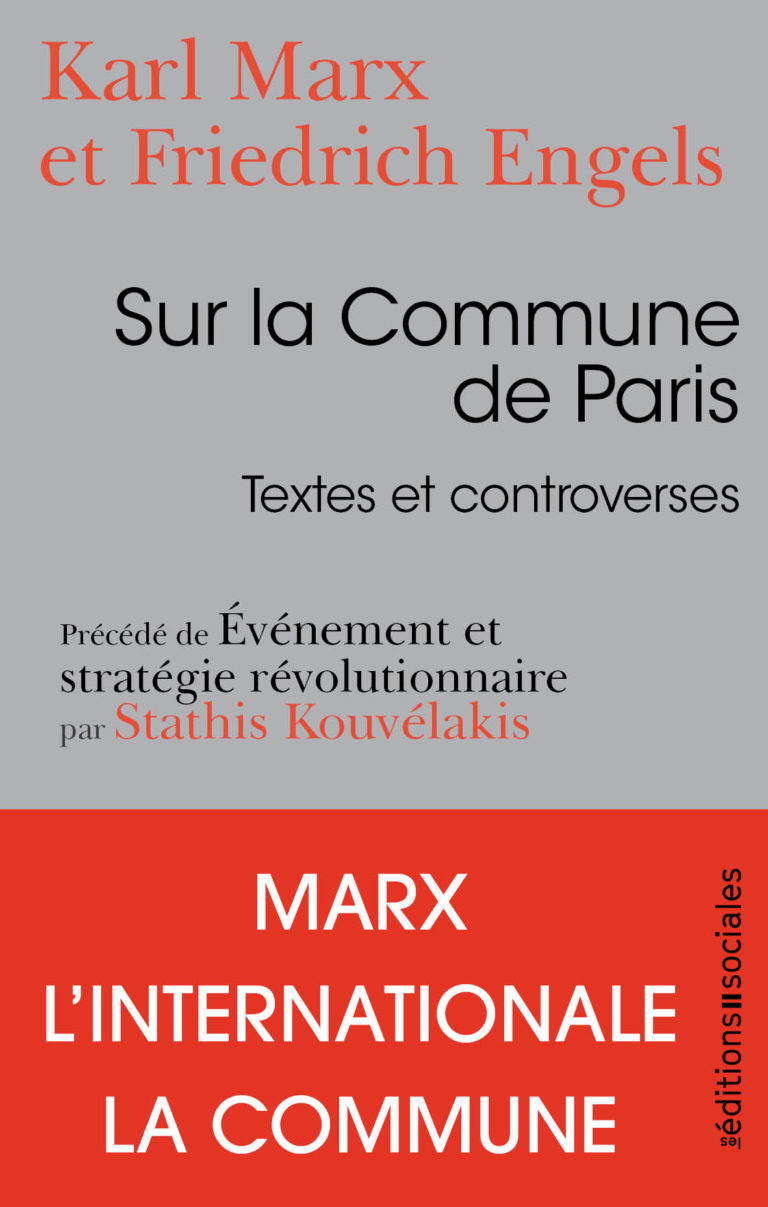Introduction d'Engels à la troisième édition allemande (1891) de La Guerre civile en France
Présentation par Jean Quétier,
docteur en philosophie de l’Université de Strasbourg.
Après la mort de Marx, Engels consacre une part non négligeable de son temps à organiser la diffusion des œuvres de son célèbre ami, ce qui le conduit régulièrement à rédiger des préfaces à la réédition de certains textes dont il entend souligner l’importance. Ce faisant, Engels ne se contente pas de rappeler le contexte dans lequel ils ont été écrits, mais procède souvent à un travail d’actualisation des analyses de Marx. C’est notamment le cas en ce qui concerne la troisième édition allemande de La Guerre civile en France, parue en 1891 à l’occasion du vingtième anniversaire de la Commune de Paris. Dans son introduction, Engels souligne lui-même la nécessité de procéder à « quelques additions » par rapport au diagnostic formulé à chaud par Marx deux décennies plus tôt. D’une part, Engels insiste plus nettement sur les limites des mesures prises par les communards, et en particulier sur « le saint respect avec lequel on s’arrêta devant les portes de la Banque de France ». Il les impute pour l’essentiel à un manque de lucidité, directement explicable par les convictions politiques des communards, majoritairement blanquistes ou proudhoniens. Mais d’autre part, Engels entend également donner à la Commune de Paris le statut de point de repère au sein de la réflexion stratégique de la social-démocratie allemande. C’est ce qui le conduit ici à présenter cet épisode révolutionnaire comme une préfiguration de la « dictature du prolétariat » qu’il appelle de ses vœux.
Si, aujourd’hui, vingt ans après, nous jetons un regard en arrière sur l’activité et la signification historique de la Commune de Paris de 1871, il apparaît qu’il y a quelques additions à faire à la peinture qu’en a donnée La Guerre civile en France.
Les membres de la Commune se divisaient en une majorité, les blanquistes, qui avait déjà dominé dans le Comité central de la Garde nationale, et une minorité, les membres de l’Association internationale des travailleurs, se composant pour la plupart de socialistes proudhoniens. Dans l’ensemble, les blanquistes n’étaient alors socialistes que par l’instinct révolutionnaire, prolétarien ; seul un petit nombre d’entre eux étaient parvenus, grâce à Vaillant, qui connaissait le socialisme scientifique allemand, à une plus grande clarté des principes. Ainsi s’explique que, sur le plan économique, bien des choses aient été négligées, que, selon notre conception d’aujourd’hui, la Commune aurait dû faire. Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s’arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut d’ailleurs une lourde faute politique. La Banque aux mains de la Commune, cela valait mieux que dix mille otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la Commune. Mais le plus merveilleux encore, c’est la quantité de choses justes qui furent tout de même faites par la Commune composée de blanquistes et de proudhoniens. Il va sans dire que la responsabilité des décrets économiques de la Commune, de leurs côtés glorieux ou peu glorieux, incombe en première ligne aux proudhoniens, comme incombe aux blanquistes celle de ses actes et de ses carences politiques. Et dans les deux cas l’ironie de l’histoire a voulu – comme toujours quand les doctrinaires arrivent au pouvoir – que les uns comme les autres fissent le contraire de ce que leur prescrivait leur doctrine d’école.
Proudhon, le socialiste de la petite paysannerie et de l’artisanat, haïssait positivement l’association. Il disait qu’elle comportait plus d’inconvénients que d’avantages, qu’elle était stérile par nature, voire nuisible, parce qu’elle mettait une entrave à la liberté du travailleur ; dogme pur et simple, improductif et encombrant, contredisant tout autant la liberté du travailleur que l’économie du travail, ses désavantages croîtraient plus vite que ses avantages ; en face d’elle, la concurrence, la division du travail, la propriété privée resteraient des forces économiques. Ce n’est que pour les cas d’exception – comme Proudhon les appelle – de la grande industrie et des grandes entreprises, par exemple les chemins de fer, que l’association des travailleurs serait à sa place (voir Idée générale de la révolution, 3e étude).
En 1871, même à Paris, ce centre de l’artisanat d’art, la grande industrie avait tellement cessé d’être une exception que le décret de loin le plus important de la Commune instituait une organisation de la grande industrie et même de la manufacture, qui devait non seulement reposer sur l’association des travailleurs dans chaque fabrique, mais aussi réunir toutes ces associations dans une grande fédération ; bref, une organisation, qui, comme Marx le dit très justement dans La Guerre civile, devait aboutir finalement au communisme, c’est-à-dire à l’exact opposé de la doctrine de Proudhon. Et c’est aussi pourquoi la Commune fut le tombeau de l’école proudhonienne du socialisme. Cette école a aujourd’hui disparu des milieux ouvriers français ; c’est maintenant la théorie de Marx qui y règne sans conteste, chez les possibilistes non moins que chez les «marxistes». Ce n’est que dans la bourgeoisie «radicale» qu’on trouve encore des proudhoniens.
Les choses n’allèrent pas mieux pour les blanquistes. Élevés à l’école de la conspiration, liés par la stricte discipline qui lui est propre, ils partaient de cette conception qu’un nombre relativement petit d’hommes résolus et bien organisés était capable, le moment venu, non seulement de s’emparer du pouvoir, mais aussi, en déployant une grande énergie et de l’audace, de s’y maintenir assez longtemps pour réussir à entraîner la masse du peuple dans la révolution et à la rassembler autour de la petite troupe directrice. Pour cela, il fallait avant toute autre chose la plus stricte centralisation dictatoriale de tout le pouvoir entre les mains du nouveau gouvernement révolutionnaire. Et que fit la Commune qui, en majorité, se composait précisément de blanquistes ? Dans toutes ses proclamations aux Français de la province, elle les conviait à une libre fédération de toutes les communes françaises avec Paris, à une organisation nationale qui, pour la première fois, devait être effectivement créée par la nation elle-même. Quant à la force répressive du gouvernement naguère centralisé, l’armée, la police politique, la bureaucratie, créées par Napoléon en 1798, reprises, depuis, avec reconnaissance par chaque nouveau gouvernement et utilisées par lui contre ses adversaires, c’est justement cette force qui devait partout être renversée, comme elle l’avait été déjà à Paris.
La Commune dut reconnaître d’emblée que la classe ouvrière, une fois parvenue à la domination, ne pouvait continuer à opérer avec la vieille machine d’État ; pour ne pas perdre à nouveau sa propre domination qu’elle venait à peine de conquérir, cette classe ouvrière devait, d’une part, éliminer la vieille machine d’oppression jusqu’alors employée contre elle-même, mais, d’autre part, prendre des assurances contre ses propres élus et fonctionnaires en les proclamant, en tout temps et sans exception, révocables. En quoi consistait la propriété caractéristique de l’État tel qu’il existait jusqu’ici ? La société avait créé, par simple division du travail à l’origine, ses organes propres pour veiller à ses intérêts communs. Mais, avec le temps, ces organismes, dont le sommet était le pouvoir de l’État, s’étaient transformés, en servant leurs propres intérêts particuliers, de serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci.
On peut le voir, par exemple, non seulement dans la monarchie héréditaire, mais également dans la république démocratique. Nulle part les « politiciens » ne forment une section plus isolée et plus puissante au sein de la nation qu’en Amérique du Nord, précisément. Là, chacun des deux grands partis, qui se relaient au pouvoir, est lui-même dirigé par des gens qui font de la politique une affaire, spéculent sur les sièges aux assemblées législatives de l’Union comme à celles des États, ou qui vivent de l’agitation pour leur parti et sont récompensés de sa victoire par des postes.
On sait bien combien les Américains cherchent depuis trente ans à secouer ce joug devenu insupportable, et comment, malgré tout, ils s’enfoncent toujours plus profondément dans ce marécage de la corruption. C’est précisément en Amérique que nous pouvons le mieux voir comment le pouvoir d’État parvient à l’indépendance envers la société, dont, à l’origine, il ne devait être qu’un simple instrument. Là n’existe ni dynastie, ni noblesse, ni armée permanente (à part la poignée de soldats commis à la surveillance des Indiens), ni bureaucratie avec postes fixes et droits à la retraite. Et pourtant, nous avons là deux grandes bandes de politiciens spéculateurs, qui se relaient pour prendre possession du pouvoir d’État et l’exploitent avec les moyens les plus corrompus et pour les fins les plus corrompues; et la nation est impuissante en face de ces deux grands cartels de politiciens qui sont soi-disant à son service, mais, en réalité, la dominent et la pillent.
Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs, de l’État et des organes de l’État, à l’origine serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places, de l’administration, de la justice et de l’enseignement, au choix des intéressés par élection au suffrage universel, et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et, deuxièmement, elle ne rétribua tous les services, des plus bas aux plus élevés, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu’elle ait accordé était de 6 000 francs. Ainsi, on mettait le holà à la chasse aux places et à l’arrivisme, sans même en appeler aux mandats impératifs des délégués aux corps représentatifs qui venaient compléter le reste.
Cette démolition du pouvoir d’État tel qu’il était jusqu’ici et son remplacement par un pouvoir nouveau, vraiment démocratique, sont dépeints en détail dans la troisième partie de La Guerre civile. Mais il est nécessaire de revenir ici brièvement sur quelques-uns de ses traits, parce que, en Allemagne précisément, la superstition de l’État a passé de la philosophie dans la conscience commune de la bourgeoisie et même dans celle de beaucoup d’ouvriers. Dans la conception des philosophes, l’État est « la réalisation de l’Idée » ou le règne de Dieu sur terre traduit en langage philosophique, le domaine où la vérité et la justice éternelle se réalisent ou doivent se réaliser. De là cette vénération superstitieuse de l’État et de tout ce qui s’y rapporte, vénération qui s’installe d’autant plus facilement qu’on est, depuis le berceau, habitué à s’imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu’ici, c’est-à-dire par l’État et ses autorités dûment établies. Et l’on croit déjà avoir fait un pas prodigieusement hardi, quand on s’est affranchi de la foi en la monarchie héréditaire et qu’on jure par la république démocratique. Mais, en réalité, l’État n’est rien d’autre qu’une machine pour l’oppression d’une classe par une autre, et cela, tout autant dans la république démocratique que dans la monarchie; le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s’empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu’à ce qu’une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce fatras de l’État.
Le philistin social-démocrate88 a été récemment saisi d’une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. Eh bien, messieurs, voulez-vous savoir à quoi ressemble cette dictature ? Regardez la Commune de Paris. C’était la dictature du prolétariat.
Londres, pour le vingtième anniversaire de la Commune de Paris, 18 mars 1891



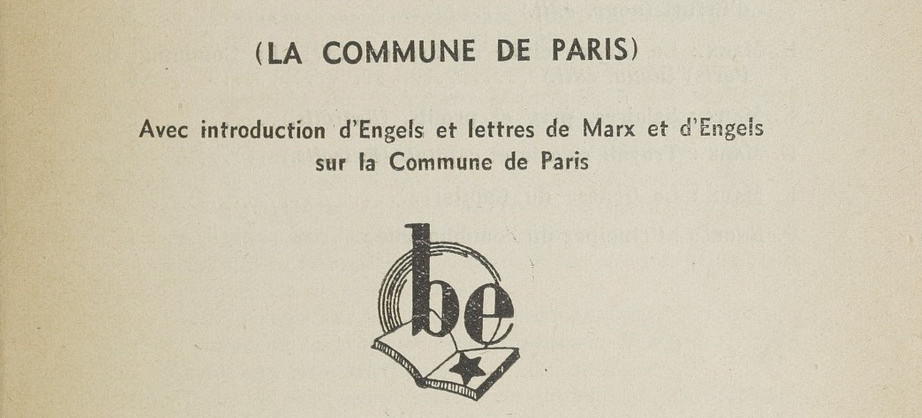
 Retour
Retour