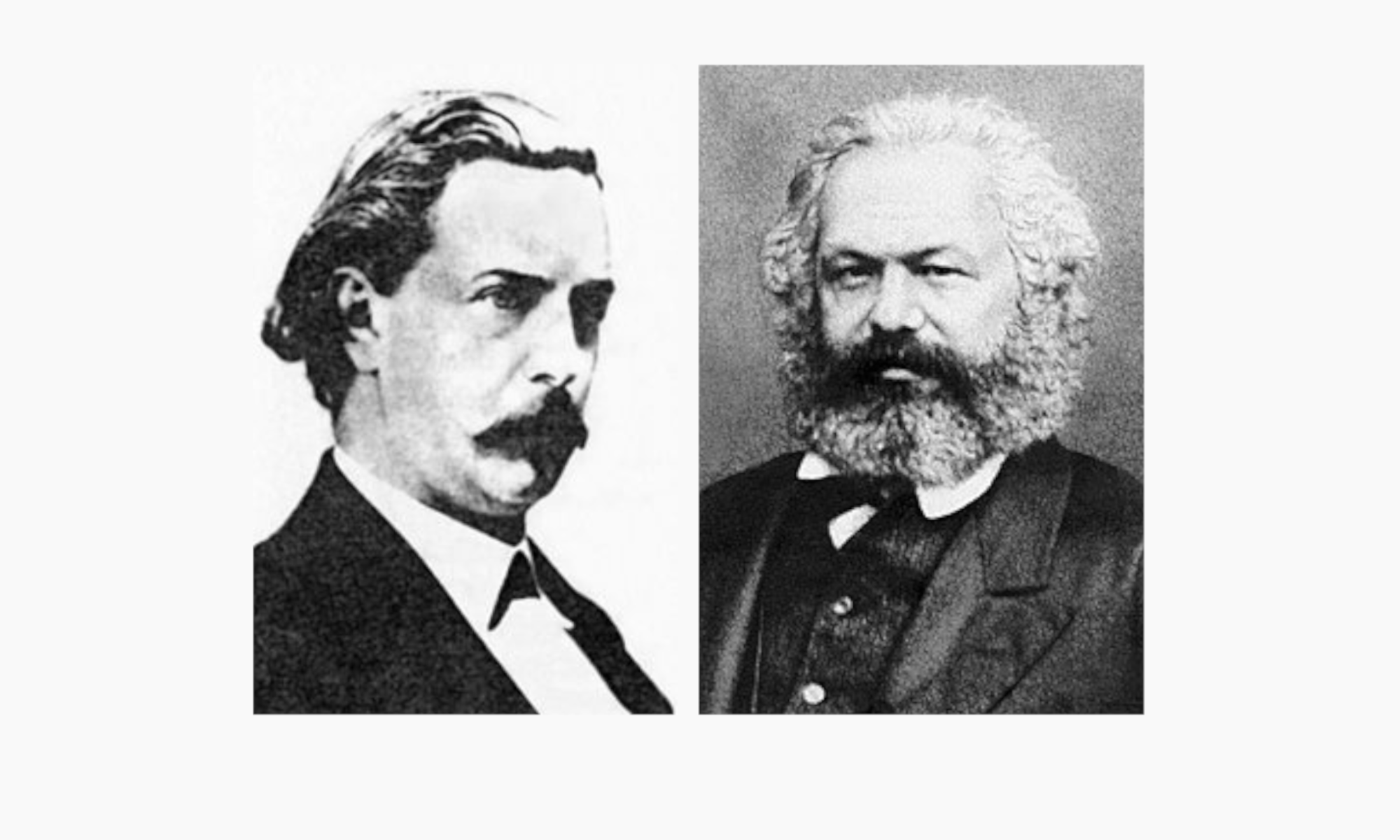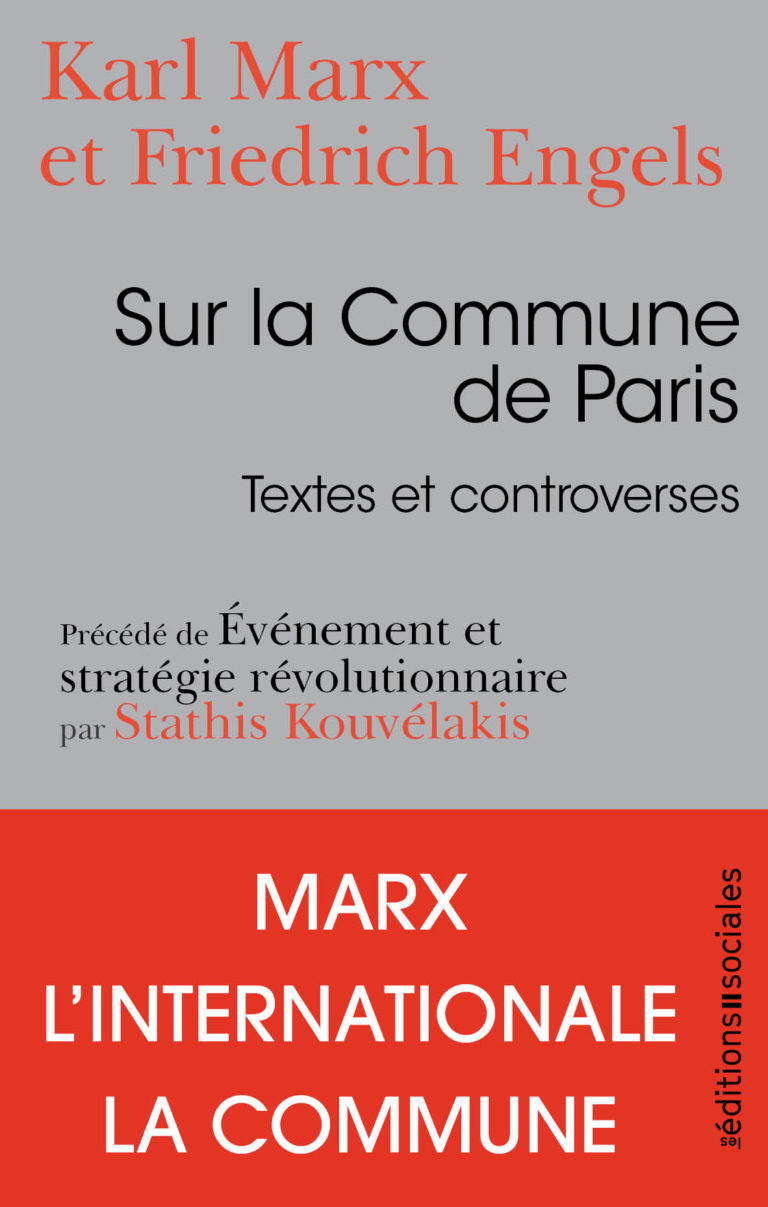Lettre de Marx à Ludwig Kugelmann du 12 avril 1871
Présentation par Jean Quétier,
docteur en philosophie de l’Université de Strasbourg.
La correspondance de Marx et d’Engels constitue une source précieuse permettant de donner à voir, sous différentes facettes, l’appréciation qu’ils portent sur la Commune de Paris. Certaines lettres sont rédigées après coup, d’autres au contraire, comme celle que Marx adresse le 12 avril 1871 à son ami Ludwig Kugelmann, médecin socialiste résidant à Hanovre, sont écrites à chaud, alors que le destin de cet épisode révolutionnaire n’est pas encore scellé. Dans ce texte, le jugement de Marx apparaît dans toute sa complexité. D’une part, l’enthousiasme est palpable : Marx ne souligne pas seulement la « grandeur » et la « capacité de sacrifice » qui caractérise la conduite des communards, il perçoit également dans leur action une confirmation du diagnostic formulé deux décennies plus tôt dans son ouvrage Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte au sujet de la stratégie révolutionnaire à adopter face au pouvoir d’État, qu’il s’agit de « briser » et non de transférer en d’autres mains. D’autre part, Marx ne dissimule pas ses critiques à l’égard de décisions qu’il perçoit comme de possibles facteurs de défaite. Il reproche aux communards – « trop gentils » – de faire preuve d’une certaine naïveté et de se priver ainsi des armes qui leur auraient peut-être permis de résister à la répression brutale dont ils n’allaient pas tarder à faire l’objet.
Lettre publiée dans Karl Marx, Friedrich Engels, Sur la Commune de Paris. Textes et controverses, Paris, Éditions sociales, 2021, p. 280-281.
Londres, le 12 avril 1871
Cher Kugelmann,
[…]
Nous avons reçu hier la nouvelle nullement rassurante que Lafargue (sans Laura) était pour l’instant à Paris.
Si tu relis le dernier chapitre de mon Dix-huit Brumaire, tu verras que j’y exprime l’idée suivante : la prochaine tentative révolutionnaire en France ne devra pas, comme cela s’est produit jusqu’ici, faire changer la machinerie bureaucratico-militaire de main, mais lebriser. Et c’est condition préalable de toute véritable révolution populaire sur le continent. C’est bien là d’ailleurs ce que tentent nos héroïques camarades parisiens. Quelle souplesse, quelle initiative historique, quelle capacité de sacrifice chez ces Parisiens ! Après avoir été, pendant six mois, affamés et désorganisés par la trahison intérieure plus encore que par l’ennemi extérieur, voilà qu’ils se soulèvent, sous la menace des baïonnettes prussiennes, comme si l’ennemi n’était pas toujours aux portes de Paris, comme s’il n’y avait pas eu de guerre entre la France et l’Allemagne ! L’histoire ne connaît pas d’autre exemple de pareille grandeur! S’ils succombent, ce sera uniquement pour avoir été « trop gentils ». Il eût fallu marcher tout de suite sur Versailles, une fois que Vinoy d’abord, puis la fraction réactionnaire de la Garde nationale de Paris eurent d’eux-mêmes
laissé le champ libre. Par scrupules de conscience, on laissa passer le moment opportun. On ne voulait pas déclencher la guerre civile, comme si ce mischievous [méchant] avorton de Thiers ne l’avait pas déjà déclenchée en tentant de désarmer Paris! Deuxième faute : le Comité central résilia ses pouvoirs trop tôt, pour faire place à la Commune. Encore par un souci excessif d’«honnêteté»! Quoi qu’il en soit, l’actuel soulèvement de Paris, même s’il succombe sous l’assaut des loups, des porcs et des sales chiens de la vieille société –, est l’exploit le plus glorieux de notre parti depuis l’insurrection parisienne de juin [1848]. Que l’on compare les Parisiens se lançant à l’assaut du ciel aux esclaves célestes du Saint-Empire romain prusso-germanique, avec ses mascarades posthumes et ses relents de caserne et d’église, de féodalité racornie et surtout de bourgeoisie philistine.
[…]