Depuis ces trente dernières années, nous vivons en Europe une profonde crise de l’accueil des populations qui quittent leur pays par choix ou sous la contrainte du fait de la misère, des persécutions et des conflits. Cette crise s’est aggravée en 2015 avec la guerre en Syrie qui a suivi celle en Libye. En réaction aux politiques de fermeture, d’enfermement et d’expulsion mises en oeuvre par l’Union européenne et ses Etats-membres, des gestes d’hospitalité à l’initiative d’individus, d’associations et de collectivités locales se sont multipliés affirmant la solidarité et la fraternité contre le repli des Etats-nations. Pour éclairer ces enjeux, la Fondation a invité Michel Agier qui défend la reconnaissance d’un principe d’hospitalité et d’un droit à la mobilité pour toutes et tous, ouvrant la voie à une citoyenneté nomade.
Cette rencontre qui s’est tenue dans le cadre des débats du village du livre à la Fête de l’humanité 2019, est un préambule à un nouveau cycle que lance la Fondation sur les migrations et les frontières aujourd’hui. Nous vous en proposons ici l’enregistrement audio et la transcription :
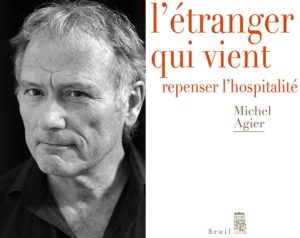 Anthropologue, directeur d’études à l’Ecole des Hautes études en Sciences sociales (EHESS) et chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Michel Agier a écrit une quinzaine d’ouvrages sur l’urbain, les camps, les exilés, parmi lesquels Le Couloir des exilés en 2011, La condition cosmopolite (La Découverte, 2013), Les migrants et nous. Comprendre Babel (CNRS éditions, 2016), La jungle de Calais. Les migrants, la frontière et le camp avec Y. Bouagga, M. Galisson, C. Hanappe, M. Pette et P. Wannesson (PUF, 2018), et L’étranger qui vient. Repenser l’hospitalité (Seuil, 2018). Dans ce dernier livre, il ouvre des perspectives sur les enjeux cruciaux de la mobilité, de la condition de l’étranger, de l’altérité et de notre rapport à celui qui vient d’ailleurs. Une réflexion anthropologique, philosophique et politique qui aide à penser un monde vivable pour tous doté de dispositifs politiques, sociaux et juridiques à la hauteur des enjeux contemporains.
Anthropologue, directeur d’études à l’Ecole des Hautes études en Sciences sociales (EHESS) et chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Michel Agier a écrit une quinzaine d’ouvrages sur l’urbain, les camps, les exilés, parmi lesquels Le Couloir des exilés en 2011, La condition cosmopolite (La Découverte, 2013), Les migrants et nous. Comprendre Babel (CNRS éditions, 2016), La jungle de Calais. Les migrants, la frontière et le camp avec Y. Bouagga, M. Galisson, C. Hanappe, M. Pette et P. Wannesson (PUF, 2018), et L’étranger qui vient. Repenser l’hospitalité (Seuil, 2018). Dans ce dernier livre, il ouvre des perspectives sur les enjeux cruciaux de la mobilité, de la condition de l’étranger, de l’altérité et de notre rapport à celui qui vient d’ailleurs. Une réflexion anthropologique, philosophique et politique qui aide à penser un monde vivable pour tous doté de dispositifs politiques, sociaux et juridiques à la hauteur des enjeux contemporains.
Faire de l’hospitalité un principe juridique et dépasser la citoyenneté nationale
2015, un tournant
L’année 2015 marque un tournant. Un débat public et polémique s’est ouvert sur une réalité devenue plus visible et explicite : Les États n’ont ni politique d’accueil, ni politique migratoire qui permettent de faire face à l’état de la mobilité dans le monde. La création de l’Europe de Schengen fixe ce cadre depuis 1995, mais 2015 a retourné la situation.
La mobilité est pourtant un fait ordinaire. Tout le monde se déplace et de plus en plus, les moyens de circulation se sont développés d’un point à l’autre de la planète. En temps de crise, les populations se déplacent encore davantage fuyant la misère, les catastrophes naturelles, les conflits, les guerres et les violences. Les déplacements ne vont pas s’arrêter. Or, on constate depuis les années 2000 que les États n’ont qu’une réponse sécuritaire à la mobilité internationale, celle de la fermeture des frontières pour protéger la nation et le territoire, une mission qui sur le fond reste très discutable et mérite d’être débattue. Thomas Piketty y fait allusion lorsqu’il affirme que cette politique-là est une politique de propriétaires où l’on considère que le territoire national sur lequel on vit nous appartient. Toute une pensée philosophique et politique appuie cette idée qui est contradictoire avec la libre circulation de tous.
L’hospitalité révélatrice du conflit entre État-nation et citoyens
2015 met en évidence une crise de confiance des citoyens à l’égard de leur État qui se refuse à accueillir correctement les nouveaux arrivants. Ces mêmes citoyens ont alors réinventé l’hospitalité là où ils ont vu de l’inhospitalité. Un fantastique mouvement de solidarité, de fraternité se créé en France et en Europe par opposition à des États non accueillants, inhospitaliers. Ce conflit autour du mot « hospitalité » a enclenché beaucoup de choses parfois négatives, ce qui s’est vérifié dans les enquêtes réalisées pendant trois ans par le groupe de recherche Babels. De nombreuses difficultés et malentendus se sont produits dans cette hospitalité au sens strict, selon le principe « j’accueille chez moi qui je veux », « l’État ne vient pas mettre son nez dans ma maison », parce que nos sociétés ne sont plus organisées autour de l’échange social qui dans d’autres sociétés fait de l’hospitalité une pratique ordinaire. Il y a une chambre pour l’étranger, des rituels connus qui font de lui un hôte sans pour autant y mettre une charge affective comme on l’a vu en France et en Europe, où il a fallu un énorme investissement et une forte mobilisation pour concrétiser ces gestes d’accueil.
En même temps, cela a recréé du collectif et un tissu social. 1200 associations d’aide aux migrants ont été recensées en 2018 dont le quart pour aider directement les gens à porter secours individuellement et héberger les migrants. En comparant avec d’autres exemples d’hospitalité pratiqués dans des sociétés ou des communautés qui n’en ont pas perdu l’habitude, on ne peut s’empêcher de penser que cela a recréé de la communauté dont on a toujours besoin, surtout dans des sociétés hyper-individualisées comme les nôtres.
Qui est l’étranger ?
Que l’on soit hospitalier ou hostile, on est toujours confronté à la même question anthropologique : qui est l’étranger ? Celui qui lui est hostile le rejette. L’hospitalier, lui, veut en faire son hôte allant même jusqu’à défendre l’idée qu’il n’y a pas d’étranger sur terre. Pour ma part, je ne dis pas qu’il n’y a pas d’étranger, ce serait utopique de l’affirmer, ni qu’il n’y a pas de frontière ; je pars au contraire du constat que nous sommes tous à un certain moment étrangers et nous le sommes de plus en plus dans ce monde car les contextes dans leur diversité font de cette condition d’étranger une condition qui est plus largement partagée. Le développement de la mobilité nous fait outsider, venant d’ailleurs. Que l’on soit blanc, noir, parlant une autre langue, on est alors regardé comme un intrus, comme l’étranger qui vient. Les langues différentes, les manières de se tenir, de se nourrir, de s’habiller, ce sont toutes ces dimensions qui font que l’étranger parait étrange. Mais cette étrangeté est toujours relative. Il suffit de commencer un échange, une rencontre – et c’est tout le travail des ethnologues – pour se rendre compte que si d’abord on est étranger à une société, petit à petit on commence à comprendre, comme un enfant qui découvre les autres.
Produire du droit, du village…
La condition d’étranger recouvre aussi une dimension juridique et politique très importante. Être étranger c’est avoir ou non des droits par rapport à un idéal de droit qui est celui de la citoyenneté, et plus précisément de celle de l’État-nation auquel on appartient. Cette appartenance nous protège et donne des droits. C’est à partir de cette citoyenneté que l’on peut mesurer le degré d’extranéité des étrangers. On pourrait classer mondialement les pays en fonction des droits qu’ils donnent aux étrangers ! Par exemple, le droit de vote aux élections municipales. Les Européens non Français ont le droit de vote aux élections municipales mais les non-Européens non. Or accorder le droit de vote à l’étranger réduit son extranéité et le rapproche de la citoyenneté. De même, le droit au travail pour les demandeurs d’asile n’est pas le même dans tous les pays. En Europe du nord, après six mois dans un pays, le nouvel arrivant peut travailler. En France, il fallait jusqu’à récemment attendre un an, ce délai a été réduit à 9 mois. Cette extranéité, qui rend juridiquement étranger, résulte d’une décision politique.
Au niveau de villages ou de petites villes, il est possible de produire du droit pour les migrants. Des maires ou des adjoints au maire ont le pouvoir de signer un papier de réquisition sans demander au préalable si les personnes qui seront logées sont en règle ou non. Localement, on est donc capable de créer du droit. Dans un village, il peut être décidé que le droit au logement sera donné à l’étranger.
…à l’échelle planétaire
Face à ce phénomène mondial de la mobilité, il est nécessaire de trouver une solution à l’échelle, au niveau global, que l’on peut nommer cosmopolitique. Le Pacte mondial pour les migrations dit Pacte de Marrakech, adopté par les Nations unies en décembre 2018, a apporté un début de réponse. Mais cette tentative des Nations unies de réunir les États pour commencer un dialogue sur les migrations a immédiatement suscité l’opposition des partis d’extrême droite qui se sont mobilisés pour mettre en échec cette réflexion commune. Il s’agit là pourtant de l’autre domaine où l’on peut faire avancer le droit et notamment, l’idée de transformer l’hospitalité en un principe juridique – nous y travaillons avec Mireille Delmas-Marty – qui serait posé à cette échelle mondiale pour ensuite, non pas obliger les États, mais permettre au tissu associatif de contrecarrer les politiques hostiles à l’égard des migrants. On a pu le faire en France avec le mot « fraternité », qui a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité avant d’être opposé à une décision de justice au nom du principe de fraternité.
Je redis comme d’autres, et avec le philosophe René Schérer, que le national est la catastrophe de l’hospitalité. Il faudra se mobiliser sans relâche avant que l’État ne se décide à aller dans le sens d’un principe juridique d’hospitalité. Faire de la politique dans ce cas-là, c’est littéralement faire les choses et ne pas demander à l’État de les faire à notre place. Les enquêtes sur les pratiques d’hospitalité montrent qu’il y a deux manières de se politiser : celle qui consiste à protester contre l’État et à lui demander de prendre en charge la question sans toutefois obtenir de réponse ; et l’autre qui fait les choses à la manière des petites communautés de zadistes, et affirme que l’on peut accueillir même si l’on se place dans l’illégalité. On retrouve ces pratiques dans les villages, les petites villes, les quartiers où se dessine une autre voie politique.
Pour une citoyenneté nomade
La revue de(s) générations a consacré deux numéros à l’hospitalité (n°29) et à l’inhospitalité (n°30, lire l’édito de Camille Fallen et Jean-Marc Cerino). J’y ai réalisé un entretien que je leur ai proposé d’intituler « Rassurer les nomades, repenser la citoyenneté » parce que nous ne pouvons plus nous contenter d’une citoyenneté nationale. J’y évoque la possibilité d’une citoyenneté nomade qui se déplacerait avec les gens parce qu’ils ont le besoin absolu de se déplacer, qu’ils y soient contraints dans l’urgence ou qu’ils le souhaitent simplement. Tout le monde se verrait garantir le droit à la mobilité. Les Européens voyagent dans à peu près tous les pays du monde quand un habitant d’Afrique centrale ne peut voyager que dans une douzaine de pays situés pour la plupart autour de chez lui. Il existe donc un vrai problème juridique et politique à lever pour accorder ce droit à la mobilité. Il est temps, même si c’est compliqué sur le plan politique où l’action est toujours localisée et donc dirigée vers un État ou une commune. Il s’agit là d’avoir une action politique à une échelle supranationale qui ne soit pas seulement le reflet d’un désir, d’une idée d’une citoyenneté du monde, mais qui consiste à donner concrètement aux gens qui bougent un droit citoyen là où ils sont et non pas en fonction de leur couleur de peau ou de leur nationalité.
Ouvrir les frontières
L’anthropologue qui travaille sur les identités et l’altérité peut difficilement affirmer qu’il est contre les frontières ou pour leur suppression. C’est impossible car elles font partie de la vie, nous en faisons continuellement ne serait-ce que pour reconnaître l’existence de l’autre. Ce sujet complexe est souvent malmené dans le débat public où l’on ne considère que les frontières administratives et géopolitiques des États, qui sont le fruit d’une production historique longue, difficile à supprimer du jour au lendemain. Une citoyenneté nomade supranationale ne suppose pas la suppression des frontières nationales mais implique de leur donner moins d’importance, moins de poids ou simplement de les ouvrir pour permettre la liberté de circulation. À l’inverse, les États actuels nous emmurent en empêchant les autres d’entrer. L’idée de frontière, loin de contenir naturellement cette idée d’enfermement, est au contraire un espace où l’on se reconnaît mutuellement soi et l’autre, un espace de dialogue et d’échange. La frontière ne doit en aucun cas devenir un mur.
Pour aller plus loin :
- La nouvelle revue Monde commun. Des anthropologues dans la cité (PUF), a pour objectif de faire de l’anthropologie publique, c’est-à-dire de la recherche en sciences humaines et sociales qui s’adresse d’emblée à la société et à un public large, ces réflexions n’étant pas réservées à des académiques ou à des scientifiques, mais « impliquées ou engagées, coopératives ou citoyennes ». Le numéro 3 est consacré à « La multitude migrante », plus de 250 millions de personnes vivant hors de leur pays de naissance.
- Le programme Babels (Agence nationale de la recherche et Ecole des Hautes études en Sciences sociales) a développé de 2016 à 2019 des enquêtes, des ateliers publics et une série de sept petits ouvrages sur les questions posées par ladite « crise migratoire ». Le dernier volume s’intitule Hospitalité en France : Mobilisations intimes et politiques (éditions passager clandestin, Bibliothèque des frontières, 2019).
- Voir également de Michel Agier, L’étranger qui vient. Repenser l’hospitalité, Seuil, 2018.




 Retour
Retour
