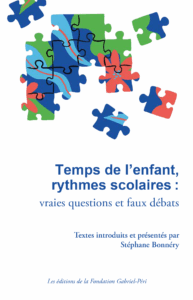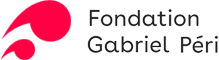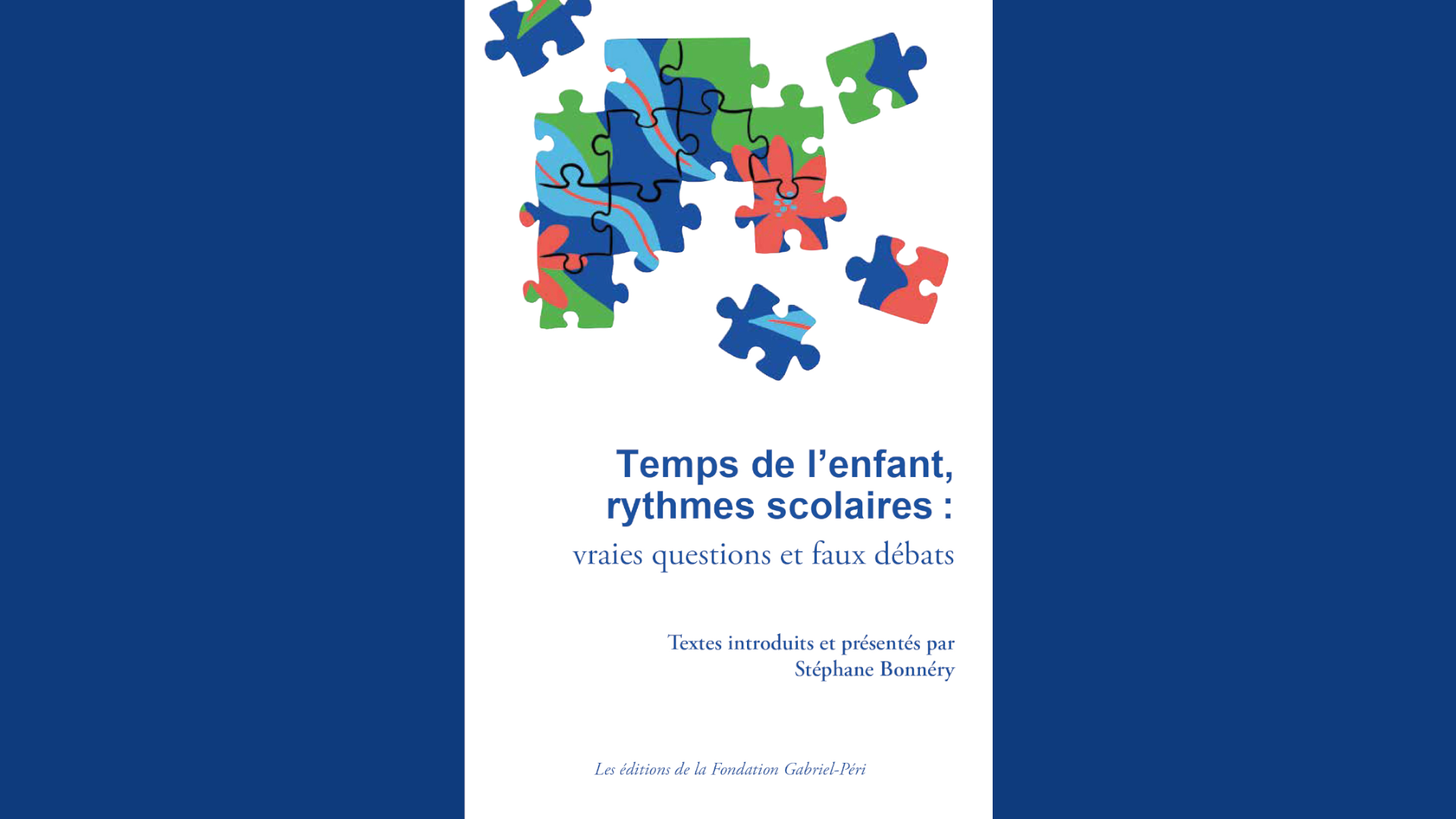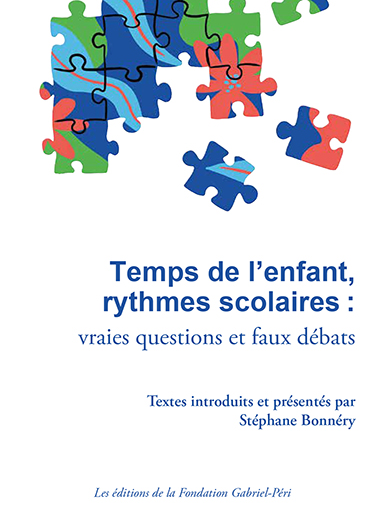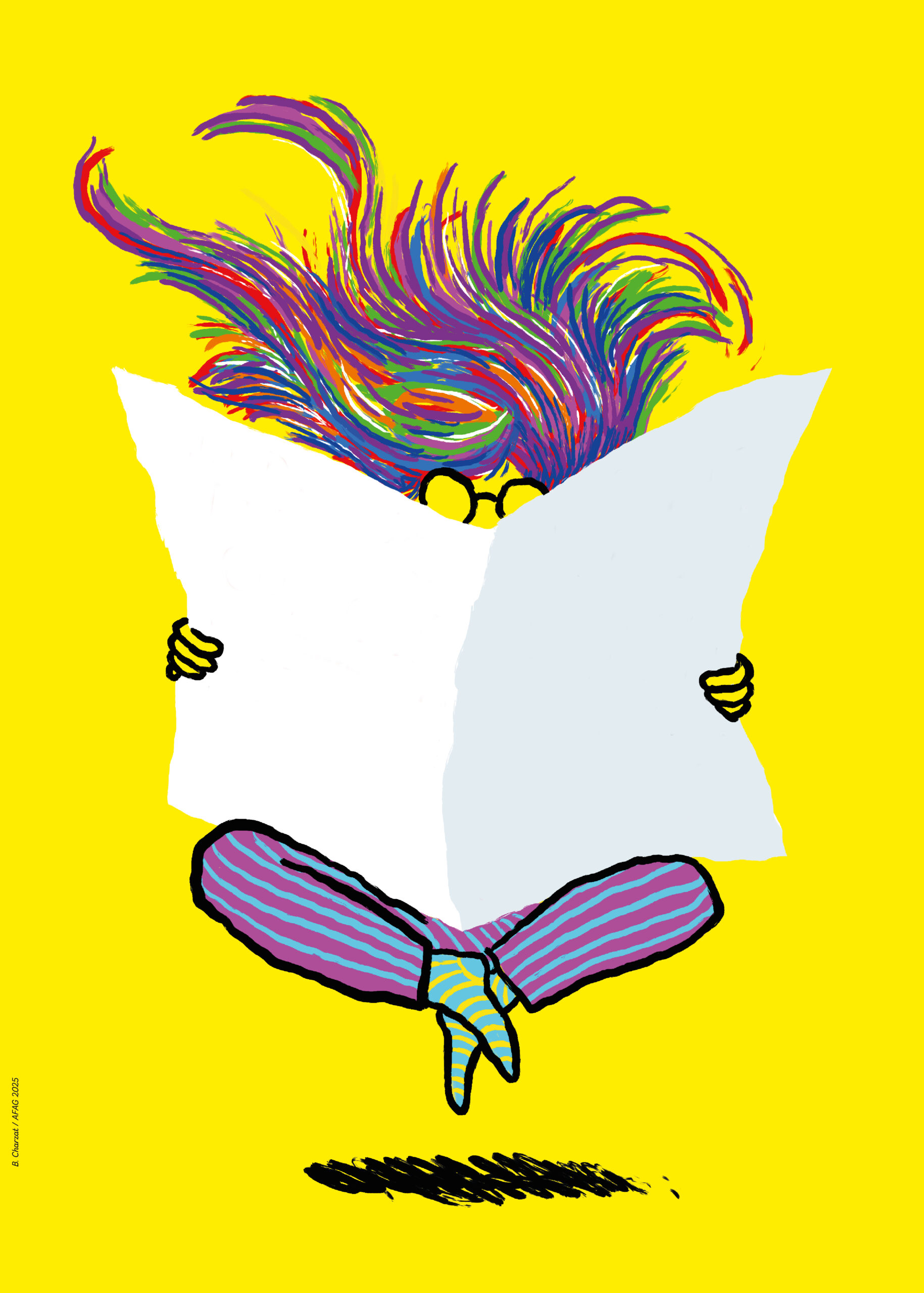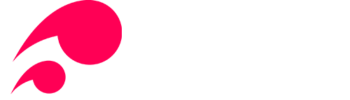Entretien avec Stéphane Bonnéry par Djéhanne Gani
Dans Le Café pédagogique, 24 novembre 2025.
Au lendemain du rapport de la convention citoyenne sur les temps de l’enfant, Stéphane Bonnery alerte sur les mauvaises réponses et « des constats justes, mais expliqués à l’envers, ce qui conduit à dégrader les situations que ces réformes prétendent améliorer ». Pour le chercheur en sciences de l’éducation et directeur de la revue Pensée, la question du temps scolaire est liée à celle du manque de temps d’école et à la question des inégalités : « réduire l’école à s’adapter à ce que sont les élèves, c’est enfermer la masse des autres élèves dans les limites de leur socialisation familiale, qui peut leur apporter beaucoup de choses, mais pas la connaissance de la culture savante, celle qui permet de réussir des études longues ».
« Il faut cesser de reprocher aux élèves leur « niveau » : la baisse de celui-ci s’explique en partie par les politiques de réduction de l’école. Ce manque de temps accroît la pression pour « aller plus vite », et laisse davantage d’élèves de côté » affirme Stéphane Bonnery, qui vient de publier Temps de l’enfant, rythmes scolaires : vraies questions et faux débats. Il répond aux questions du Café pédagogique.
Vous présentez un ouvrage intitulé Temps de l’enfant, rythmes scolaires : vraies questions, faux débats. Quelles sont ces vraies questions mal posées selon vous ?
Ce sont celles qui depuis plus de cinquante ans disent vouloir aménager les temps de l’enfant dans différentes réformes (ou dans des projets non aboutis) avec les mêmes visions biaisées qui embrouillent la compréhension. Et ce sont celles qui ont guidé la Convention citoyenne dans les mêmes travers. Des constats justes, mais expliqués à l’envers, ce qui conduit à dégrader les situations que ces réformes prétendent améliorer.
Par exemple, c’est factuel, certains enfants fatiguent plus vite que d’autres dans les activités scolaires. Mais ce constat, exact, est souvent présenté comme une explication déformée, en le faisant passer pour une cause, au travers de catégories idéologiques qui essentialisent les capacités des élèves. Selon ces idées biaisées, fatiguer plus ou moins viendrait de ce que certains seraient « doués de façon innée », ils auraient des « rythmes propres », des « compétences intrinsèques », ou un « handicap socio-culturel » parce qu’effectivement les enfants « fatigables » viennent plus souvent des familles populaires.
Ces « explications officielles » laissent entendre que c’est une fatalité (biologique, psychologique ou sociale). Autant d’idéologies fatalistes désignant les élèves comme « in-enseignables » et l’école comme impuissante. Or, ce que montrent les textes de chercheurs et formateurs réunis dans l’ouvrage, et dont ce dernier synthétise les arguments, c’est que les élèves les plus fatigables sont ceux qui ont été moins entraînés que d’autres, dans leur famille, à se concentrer sur des savoirs savants. C’est effectivement une réalité sociale. Mais la mauvaise conclusion qui en est le plus souvent tirée, c’est qu’il faudrait réduire leur temps à l’école pour s’adapter à leur fatigue !
C’est raisonner à l’envers et aggraver le problème : où, mieux qu’à l’école, peuvent-ils s’exercer à cette activité très spécifique qu’est l’étude des savoirs savants, et ainsi devenir plus endurants dans l’activité d’étude ? Et ce raisonnement à l’envers est en quelque sorte mensonger, car les élèves les moins « fatigables », et l’ouvrage le montre en détails en synthétisant des recherches, correspondent en réalité à la minorité d’enfants qui a les emplois du temps les plus lourds, y compris sur le temps de « loisirs » avec une sur-intensification scolaire en conservatoires ou en clubs : « école de musique », « école » d’arts plastiques, « école de rugby », etc. Réduire l’école obligatoire, et transférer les contenus aux loisirs privés, donc optionnels, c’est accroître les déterminismes sociaux.