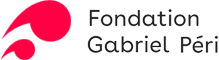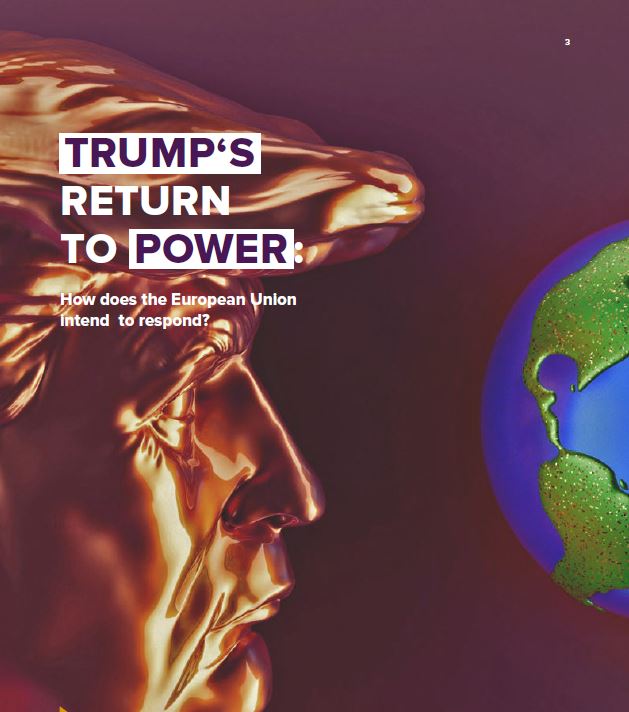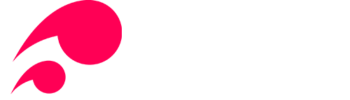Par Charlotte Balavoine, secrétaire de la Fondation Gabriel Péri, conseillère politique au Parlement européen de 2010 à 2024.
Cet article a été publié en anglais dans L’Union européenne face aux bouleversements mondiaux : tracer la voie vers la démocratie en période d’instabilité, recueil édité par le Réseau européen des fondations politiques, ENOP, juin 2025.
L’agressivité des États-Unis dans un contexte d’imbrication des économies.
Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, D. Trump et son gouvernement multiplient les outrances et les mesures coercitives à l’échelle internationale et notamment vis-à-vis de pays ou d’organisations régionales auparavant considérés comme des alliés : Canada, Mexique, Ukraine et bien évidemment Union européenne (UE). En dehors des mots et de l’abandon de la rhétorique des droits humains, chère à l’Occident depuis trois décennies pour légitimer ses ingérences et interventions à l’échelle mondiale, c’est bien une véritable guerre économique à laquelle veulent se livrer les États-Unis, y compris avec leurs « partenaires ».
Si la stratégie de la première puissance mondiale évolue, les enjeux restent quant à eux les mêmes : une volonté de relance économique dans un contexte de raréfaction des ressources et des terres rares et conserver son hégémonie à l’heure où le camp occidental est de plus en plus remis en question par les pays du Sud et où de nouvelles puissances comme la Chine sont à l’offensive.
Cela est d’autant plus alarmant pour l’Union européenne que son économie est totalement liée à celle des États-Unis. L’imbrication des politiques commerciales et industrielles entre les deux entités s’est même renforcée depuis le renouvèlement du partenariat transatlantique de 2021. À cela s’ajoute la déclaration conjointe issue du deuxième sommet UE-États-Unis du 20 octobre 2023, qui insiste sur l’approfondissement de cette « coopération afin de tenir compte des défis pressants et des possibilités émergentes qui marquent notre époque, en ce qui concerne le renforcement de notre sécurité économique, la promotion de transitions énergétiques fiables, durables, abordables et sûres, tant à l’échelle de nos économies que dans le monde entier, le renforcement du multilatéralisme et de la coopération internationale et l’exploitation de technologies numériques »[1].
Concernant la coopération économique, l’objectif est alors « un accord ciblé sur les minéraux critiques, visant à élargir l’accès à des chaînes d’approvisionnement durables, sûres et diversifiées en minéraux critiques et en batteries de haute qualité » avec comme ligne de mire la création d’un grand « club occidental des matières premières critiques » réunissant les États-Unis, l’UE et leurs alliés en mutualisant les risques dans les chaînes d’approvisionnement. Cette « solidarité » d’alliance sans limites à l’exportation est à ce moment-là vue comme un contrepoids au « risque de monopole chinois »[2].
Depuis, cette alliance est profondément remise en question par la volonté de l’administration Trump d’imposer des droits de douane drastiques à ses « alliés », mais également par les opérations agressives pour mettre la main sur les terres rares et les matières critiques. À ce titre, trois exemples illustratifs :
- L’accord imminent pour l’octroi de 50 % des terres rares de l’Ukraine aux États-Unis en échange de la continuité de leur soutien militaire alors qu’environ 5 % de toutes les « matières premières critiques » du monde se trouvent en Ukraine[3] et que l’UE a également intérêt à bénéficier de ces ressources[4].
- Les velléités de rachat du Groenland par l’administration étasunienne. Outre le fait que ce territoire autonome du Danemark serait un atout géopolitique, il possède des ressources de terres rares évaluées à 36,1 millions de tonnes (Mt) par le Service national de géologie du Danemark et du Groenland (GEUS), l’île possède un stock significatif de ces 17 métaux convoités par l’industrie de demain. L’UE avait d’ailleurs signé en novembre 2023 un partenariat stratégique sur les matières premières[5].
- Le décret signé par Donald Trump le 24 avril 2025 permettant l’extraction à grande échelle de minerais dans les grands fonds océaniques, y compris en eaux internationales. Cette mesure, contraire au droit international, permettrait aux États-Unis de récupérer des ressources telles que le cuivre, le nickel, le cobalt ou le manganèse, employées notamment dans la production de batteries, éoliennes et panneaux photovoltaïques.
Cette question des terres rares comme des métaux et matériaux critiques est au cœur de la problématique de relance économique et industrielle. Ils sont en effet essentiels à la fabrication de composants présents dans de nombreux équipements militaires et numériques. Rappelons que selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), il faudrait quadrupler la demande pour l’UE en minéraux pour répondre aux besoins de l’industrie et de la transition numérique et par six pour atteindre la neutralité carbone en 2050. D’ici là, la demande européenne en cobalt devrait augmenter de 331% et celle du nickel de 103%. Mais c’est le lithium qui devrait être l’objet de plus de convoitise avec une consommation européenne qui devrait passer de 23.000 tonnes en 2020, de 100.000 à 300.000 tonnes en 2030, selon la rapidité de la transition écologique, et de 700.000 et 860.000 tonnes en 2050[6].
Le revirement des États-Unis visant à considérer l’Union européenne comme un concurrent plutôt que comme un allié pourrait donc avoir des conséquences dramatiques pour l’économie du vieux continent[7]. En mars 2025, le journal l’Humanité magazine titrait « L’Europe va-t-elle sortir de l’histoire ? »[8].
La sidération des gouvernements européens, entre alignement et contradictions
Pourtant, face à cette menace sans précédent, la Commission européenne comme les gouvernements des États membres sont incapables de répondre de façon unie. Dans le prolongement d’une crise économique qui perdure depuis 2008, avec des taux de croissance en berne, un chômage[9] et une pauvreté élevée[10], le projet européen est de plus en plus remis en cause par des populations ayant un sentiment de déclassement. Cela se traduit sur le plan politique par la croissance rapide, voir par un retour au pouvoir de forces nationalistes ultraconservatrices et d’extrême droite. Ces forces ont pour caractéristique de ne pas rompre avec les logiques libérales sur le plan économique national[11], mais de défendre une production nationale face à une « élite transnationale » tout en désignant des groupes de populations (migrants, femmes, personnes LGBTQI+…) comme responsables de la crise globale.
En d’autres termes, le manque de réaction conjointe de l’UE face à l’offensive de Trump est d’abord politique. Une partie des dirigeants européens souscrivent au retour de dirigeants politiques ultraconservateurs, n’hésitant pas à faire preuve de mesures coercitives pour arriver à leurs fins. Plus encore : ils voient en Trump et son gouvernement des soutiens pour mener leur propre politique. Cela a été particulièrement frappant lors du premier débat au Parlement européen sur le retour de Trump au pouvoir. En effet, en janvier 2025, à la demande des groupes Renew et Socialists and Democrats (S&D), le Parlement débat sur les Conséquences géopolitiques et économiques de la nouvelle administration Trump sur les relations transatlantiques[12]. Les groupes d’extrême droite au Parlement européen saluent unanimement le retour de D. Trump au pouvoir, Jordan Bardella, président du groupe Patriotes pour l’Europe y voit même une « Alliance des classes moyennes et de l’élite entrepreneuriale ». Au « centre », les libéraux sont assez mesurés sur ce changement politique, hormis la cheffe de la délégation française, Valérie Hayer, qui à la suite du discours d’E. Macron, insiste sur la nécessité de construire un rapport de force pour faire face à « une guerre commerciale à laquelle l’Europe comme les États-Unis n’auraient aucun intérêt ». Concrètement, les partis de la « coalition » – Parti populaire européen (PPE), S&D et Renew –se retrouvent d’accord sur trois choses :
- Continuer l’investissement dans la « défense de l’Ukraine », y compris en renforçant la défense européenne en parallèle ou en complémentarité avec l’OTAN,
- Renforcer le marché intérieur donc œuvrer à une fédéralisation plus grande de l’Union européenne,
- Continuer à renforcer le partenariat transatlantique tout en appelant au multilatéralisme.
À noter que le groupe S&D, soutenu par une partie des libéraux (les Français) et du groupe de la Gauche demande également la mise en en œuvre des mesures anti-coercition[13].
Parmi les groupes qui représentent des forces gouvernementales (hormis l’extrême droite qui partage le projet politique porté par D. Trump), on peut se demander pourquoi il n’y a pas une unanimité pour faire face aux mesures prises par les États-Unis contre l’Europe. Ces divergences s’expriment également au niveau des réunions du Conseil européen qui se sont tenues depuis. Jusqu’à très récemment en effet, les dirigeants européens, sauf exception, sont restés assez silencieux face à l’agressivité des États-Unis. Le partenariat transatlantique n’est quant à lui jamais remis en question. Et pour cause : en plus des divisions politiques s’ajoutent des intérêts divergents d’un point de vue économique national.
Tous les pays à l’échelle de l’UE n’ont pas les mêmes intérêts ni la même situation économique et industrielle. Le 5 février 2025, la Fondation Gabriel Péri organisait le premier volet des Chroniques transatlantiques sur le Retour de D. Trump : quelles conséquences pour l’Europe et le monde ?[14] Lors de ce séminaire, la journaliste Natacha Polony insistait sur le fait que « dans cette guerre commerciale les Européens arrivent en ordre dispersé, car ils n’ont pas les mêmes intérêts. Le modèle allemand est en échec et l’Allemagne veut à tout prix éviter la guerre commerciale, car son économie est extrêmement imbriquée avec celle des États-Unis ».
En effet, en 2024, les États-Unis étaient le premier partenaire de l’UE pour les exportations de biens de (20,6 %) et son deuxième partenaire pour les importations de biens (13,7 %), derrière la Chine (21,3 %). Mais tous les pays ne sont pas égaux : 20 des 27 États membres de l’UE avaient une balance commerciale excédentaire vis-à-vis des États-Unis, en ce qui concerne les échanges de biens. Tout en haut du classement, on retrouve l’Allemagne, avec un excédent commercial de 92 milliards d’euros, suivie par l’Irlande (51 milliards d’euros) et l’Italie (39 milliards d’euros)[15]. À l’inverse, les Pays-Bas est le pays de l’UE qui importe le plus depuis les États-Unis : pour 25 milliards d’euros en 2024 uniquement pour les biens. Ces deux pays aux réalités économiques différentes sont totalement dépendants des États-Unis et n’ont aucun intérêt à construire un rapport de force face à Washington ni à avancer davantage vers une véritable « autonomie stratégique »[16]. À l’inverse, un pays comme la France qui a subi de plein fouet la désindustrialisation ces dernières années, se trouve au milieu des pays européens, avec un excédent commercial de 3 milliards d’euros en 2024 vis-à-vis des États-Unis. Elle a un intérêt objectif à s’éloigner de la tutelle étasunienne. Cependant, la diplomatie française, extrêmement affaiblie, est loin de convaincre largement aujourd’hui en Europe.
Car la question essentielle pour faire face à cette nouvelle phase de la guerre commerciale est bien celle de la relance industrielle et des capacités des pays de l’Union européenne à être « souverains » ou pour le moins « autonomes » sur des secteurs essentiels à l’économie et au développement notamment en termes alimentaire, numérique, énergétique, monétaire ou militaire. Autant de secteurs où les États-Unis comptent bien maintenir leur domination.
Une relance industrielle mise en avant comme une priorité par la Commission européenne, mais à l’épreuve des contradictions.
L’agressivité de la première puissance mondiale en matière industrielle n’est pas nouvelle. En effet, le caractère extraterritorial du droit américain[17] contraint depuis des années les entreprises et a entrainé des opérations de rachat agressif contre certaines grandes entreprises européennes[18]. Dans ce contexte, la question de la relance industrielle revient de façon centrale pour éviter à l’Europe le déclin inéluctable sur lequel parient les États-Unis pour maintenir leur hégémonie.
En septembre 2025, sortait le rapport Draghi[19], du nom de l’ancien président de la Banque centrale, sur l’avenir de la compétitivité européenne. Depuis, ce rapport fait beaucoup parler de lui à l’échelle européenne. Il est brandi comme la solution par une coalition allant des sociaux-démocrates aux libéraux en passant par la majorité des verts et une partie de la droite traditionnelle au niveau européen. Celui-ci fait le constat du décrochage industriel de l’Union européenne faute d’investissements massifs dans l’industrie, la recherche et l’innovation. En outre, le rapport pointe les « problèmes structurels liés au marché de l’énergie européen et à la faiblesse des investissements en infrastructures » et enfin les « dépendances concernant principalement les matériaux critiques et les ressources technologiques comme les semi-conducteurs ». Le rapport met en avant la nécessité d’investissements massifs, que le rapport estime à 750-800 milliards d’euros chaque année, pour réindustrialiser l’Europe et renforcer la sécurité énergétique notamment. Il prône également « l’achèvement de l’union des marchés de capitaux et le lancement d’une dette commune » autrement dit, un cap vers un fédéralisme plus grand au sein de l’Union européenne où la « gouvernance » serait davantage déplacée du niveau national à l’échelle de l’Union.
Depuis, la Commission a pris plusieurs mesures en terme industriel. On notera notamment la publication le 26 février 2025 du Le Clean Industrial Deal, visant à soutenir la compétitivité des industries européennes tout en accélérant leur décarbonisation. Ce plan devant mobiliser 100 milliards d’euros pour des technologies propres et des industries à forte intensité énergétique propose également des réformes structurelles pour « alléger la bureaucratie » et garantir un approvisionnement durable en matières premières critiques[20]. Des mesures spécifiques concernant notamment l’industrie automobile étaient également énoncées le 5 mars 2025[21] et d’autres concernant le secteur sidérurgique fin mars 2025[22].
Outre ces mesures, l’Union européenne mise sur sa stratégie industrielle de défense présentée en mars 2024 et donnant lieu à la publication d’un livre blanc sur la défense européenne, présenté par la Commission le 19 mars 2025[23]. Le programme lié « RearmEurope » entraine des dépenses de plus de 800 milliards d’euros afin notamment de « soutenir l’industrie européenne de la défense par un regroupement de la demande » et d’« approfondir le marché de la défense à l’échelle de l’UE ».
Autrement dit, dans un contexte de guerre commerciale de plus en plus globalisée, l’Union européenne fait le choix d’une économie de guerre, d’un renforcement des mécanismes de marché et d’une fédéralisation toujours plus importante au moment même où le projet d’intégration européenne n’a jamais été autant remis en question. Si la nouveauté tient aux investissements massifs voulus à l’échelle de l’Union, ceux-ci serviront à renforcer un projet d’intégration ancré dans la doctrine néolibérale de la concurrence et d’une puissance publique aux services de grands secteurs privés de l’économie. En cela, le projet diffère peu de ce que l’administration de D. Trump compte mener pour les États-Unis.
Quelle politique alternative l’Europe pourrait-elle mener ?
Pourtant, la question pourrait être posée différemment : comment la relance de la production industrielle en Europe pourrait-elle être bénéfique aux peuples européens, au développement humain et à la transition écologique ? En cela, l’objectif n’est plus « l’achèvement du marché de capitaux », mais bien comment reprendre le contrôle de la production pour la mettre au service des populations.
Cela voudrait par exemple dire viser la souveraineté en matière alimentaire ou énergétique afin de ne plus être dépendant de puissances extérieures. Les subventions massives de l’Union européenne pourraient servir à la renationalisation de secteurs clés de l’économie permettant de répondre aux besoins humains et écologiques. Des coopérations entre les pays européens pourraient voir le jour pour aboutir à la neutralité carbone d’ici 2050 avec la mise en place de grands pôles publics de l’énergie afin de sortir des énergies fossiles, de la volatilité des prix et de la précarité énergétique à l’échelle mondiale.
En d’autres termes, la politique néolibérale n’est pas un dogme dont on ne pourrait s’émanciper. D’autres pays font d’ailleurs des choix contraires. Après trente ans de privatisation, la Grande-Bretagne par exemple a décidé en novembre 2024 de renationaliser le secteur du rail, après avoir renationalisé une partie de son réseau électrique en 2022.
De la même façon, parvenir à une véritable « autonomie stratégique » pour l’Union européenne passe irrémédiablement par la remise en cause du partenariat transatlantique et de l’alignement – voire de la soumission – aux États-Unis. En cela, l’éloignement des centres de décisions tout comme le désinvestissement des États de leurs compétences les plus régaliennes (la sécurité et la défense notamment) n’offrent aucune garantie pour remédier à la crise industrielle, à la défiance grandissante vis-à-vis des institutions européennes, ni aux tensions croissantes à l’échelle continentale comme globale.
Poser la question de la finalité des politiques publiques revient à poser la question de qui elles servent : les travailleur.es et les populations ou les grands groupes privés et les actionnaires. De la même façon, poser la question de la finalité de la production c’est poser la question de la priorité politique que l’on se fixe : répondre aux besoins humains et de transition écologique ou conquérir de nouveaux marchés. Porter une voix alternative et sociale face aux deux écueils que sont aujourd’hui le nationalisme et la fuite en avant fédéraliste, constitue un enjeu central pour les forces de transformation sociale. C’est aussi une nécessité pour conquérir la « paix et la prospérité » si souvent promise par les dirigeants de l’UE.

[1] La déclaration commune complète est disponible sur le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_23_5198
[2] Cela étant d’autant plus vu comme un danger que les pays occidentaux ont prôné depuis trente ans le désinvestissement de l’État, notamment de la sphère industrielle et économique alors que la Chine a développé une approche commerciale et industrielle d’État quant au commerce des matériaux « stratégiques » avec une maîtrise de la chaîne de production, une planification et une montée en gamme lui permettant de devancer les pays occidentaux. Si au niveau interne le pays possède beaucoup de ressources, au niveau externe les investissements massifs en Afrique notamment, lui ont permis de détenir 90 % de la production mondiale de terres rares, ainsi que 80 % de celle de tungstène. Pékin vend donc des produits de plus en plus transformés à plus forte valeur ajoutée. À terme, sa stratégie s’étend jusqu’aux produits finis lui permettant d’être en tête sur les marchés des énergies renouvelables et de la mobilité électrique.
[3] « Terres rares et minéraux stratégiques en Ukraine », Centre régional d’information pour l’Europe occidental des Nations unies, le 19 février 2025.
[4] Seb Starcevic, “EU offers its own ‘win-win’ minerals deal to Ukraine”, Politico, le 25 février 2025.
[5] « L’UE et le Groenland signent un partenariat stratégique relatif aux chaînes de valeur durables des matières premières », communiqué de presse, Commission européenne, le 30 novembre 2023.
[6] Pour plus d’information sur le lien entre les matière premières critiques et la transition écologique, lire le volume 30-2023/1 de Alternatives Sud sur la Transition « verte » et métaux « critiques » paru en mai 2023 ; Christophe Poinssot, « Les métaux stratégiques : le nouveau défi de la transition énergétique », actes du colloque, L’énergie : bien commun de l’humanité ? Fondation Gabriel Péri, mars 2024.
[7] Charlotte Balavoine, « Les minerais rares : indépendance ou entrée en guerre froide ? », revue La Pensée n° 417, janvier-mars 2024. https://shs.cairn.info/revue-la-pensee-2024-1-page-30?lang=fr
[8] L’Humanité magazine n°945 du 13 mars 2025. https://kiosque.humanite.fr/detail/publication/detail-top-right/17/l-humanite-magazine-945?issue_id=207486&switch_toc=archive
[9] Eurostat estime que 12,978 millions de personnes dans l’UE, dont 10,830 millions dans la zone euro, ont été au chômage en décembre 2024.
[10] Eurostat estime qu’un Européen sur dix vit sous le seuil de pauvreté de son pays. Cette proportion varie du simple au triple, de 5 % en Finlande et en République tchèque à 16 % en Bulgarie. Entre 50 et 125 millions de personnes au sein de l’UE vivent dans une pauvreté extrême et n’ont pas accès l’électricité.
[11] Il ne s’agit pas pour ces forces de renforcer les services publics par exemple, mais bien de défendre une frange spécifique de l’économie : des entreprises nationales tout en mettant les ressources de l’État à leur service afin que ces entreprises soient plus compétitives à l’échelle internationale, tout en prônant une distinction en terme légal et de droits entre travailleurs nationaux et immigrés.
[12] Compte rendu in extenso des débats, le 21 juin 2025 : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-10-2025-01-21-ITM-008_FR.html
[13] Règlement (UE) 2023/2675 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers du 22 novembre 2023, initialement adopté pour contrecarrer les velléités des investisseurs chinois dans certains pays de l’UE. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/LSU/?uri=oj:L_202302675#:~:text=QUEL%20EST%20L’OBJET%20DE,membre%20de%20l’UE). Parmi les mesures théoriques qui pourraient être appliquées au pays tiers en réaction à la coercition économique, figurent l’imposition de restrictions au commerce, par exemple sous la forme de droits de douane accrus, de licences d’importation ou d’exportation, ou de restrictions dans le domaine des services ou des marchés publics.
[14] https://gabrielperi.fr/initiatives/chroniques-transatlantiques/
[15] Données Eurostat.
[16] Pour pallier le déficit d’efficacité au niveau international et les difficultés d’approvisionnement au niveau européen, une nouvelle rhétorique s’est construite autour de « l’autonomie stratégique », axe désormais central de la communication de la Commission européenne depuis quelques années, censée traduire son tournant géopolitique. Cette notion apparait pour la première fois dans les conclusions du Conseil à propos de l’industrie de défense européenne en 2013, s’est progressivement élargie aux enjeux économiques sous l’influence de la présidence française de l’UE en 2017. Elle est depuis directement associée aux politiques extérieures de l’UE, et en particulier à la politique commerciale et à la relance industrielle.
[17] Pour ne citer qu’un exemple, l’Itar (International Traffic in Arms Regulations) est une réglementation américaine qui contrôle la fabrication, la vente et la distribution d’objets et de services liés à la défense et à l’espace, tels que définis dans l’USML (United States Munitions List). L’extraterritorialité des lois américaines oblige tout industriel non américain à s’y conformer, dès lors qu’il gère l’approvisionnement et la réexportation de produits soumis aux Itar ou aux EAR (Export Administration Regulations). En résultent une dépendance, des pressions, voire des amendes susceptibles de pénaliser lourdement les entreprises européennes.
[18] Un exemple emblématique est la vente de la branche énergie d’Alstom à General Electric suite à des pressions, y compris des arrestations de certains de ces dirigeants comme Frédéric Pierucci qui raconte son expérience de quatorze mois passés en prison dans le livre Le Piège américain. Les Dessous de l’affaire Alstom. Éditions Lattès, 2019.
[19] https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en
[20] The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonization, Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions, le 26 février 2025.
[21] « Stimuler le secteur automobile européen », Commission européenne, le 5 mars 2025.
[22] Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, A European Steel and Metals Action Plan, European Commission, 19 March 2025.
[23] « La Commission dévoile le livre blanc pour une défense européenne et le plan « ReArm Europe »/Préparation à l’horizon 2030 », communiqué de presse, Commission européenne, le 19 mars 2025.