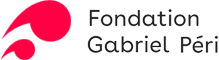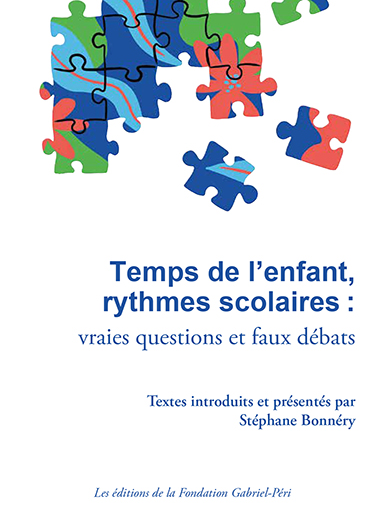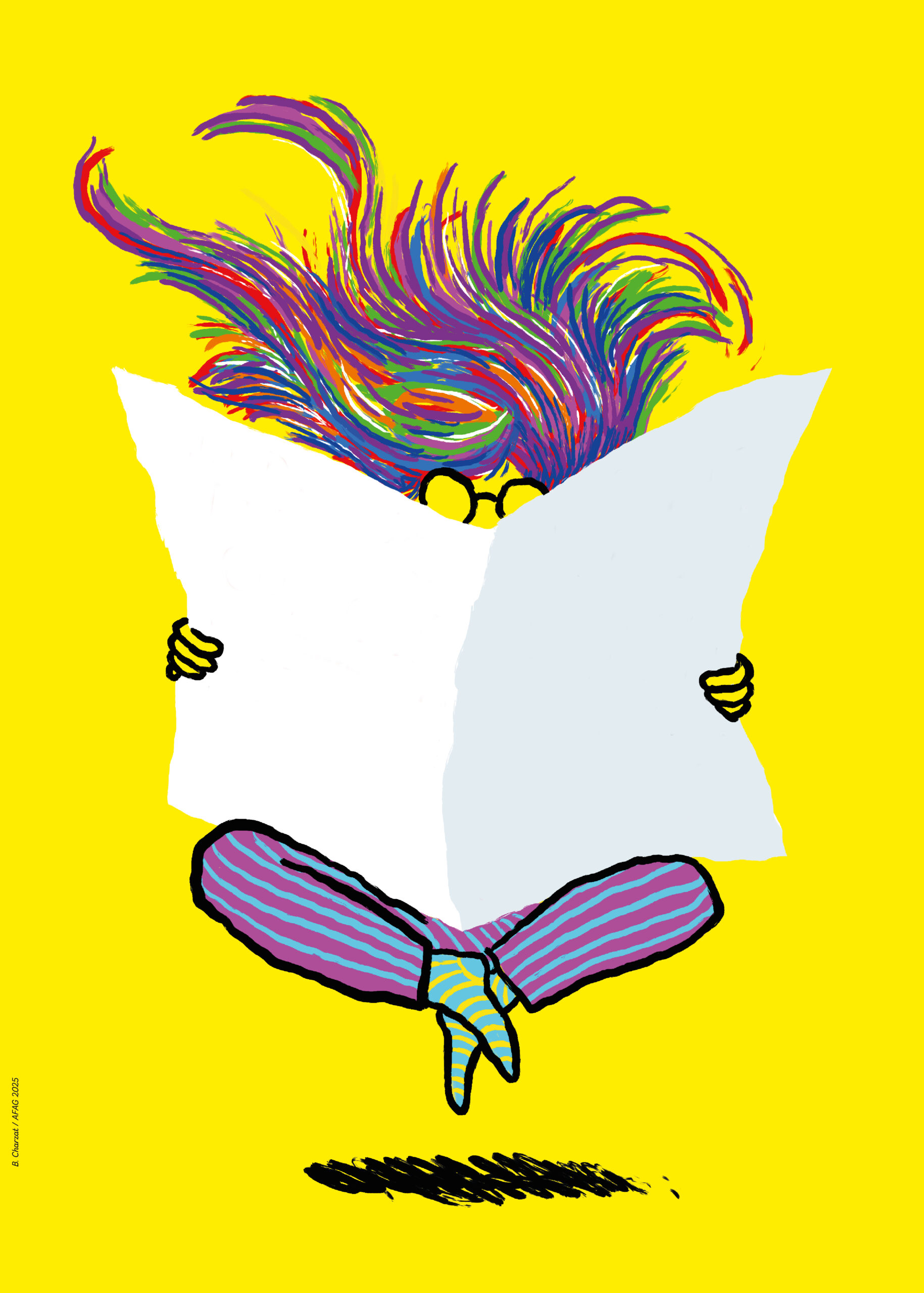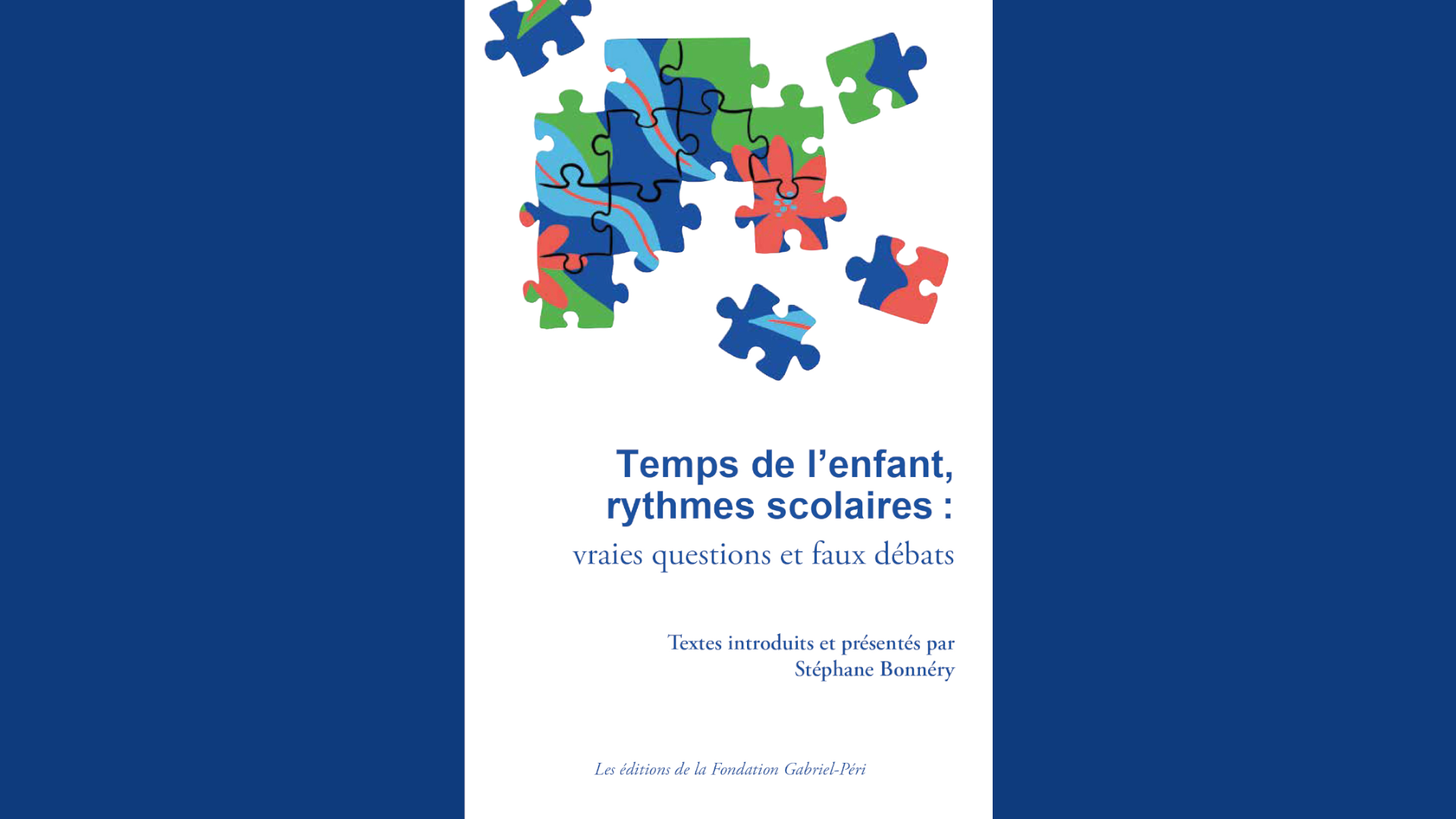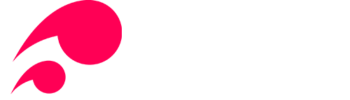Par Serge Wolikow
Historien, professeur émérite de l’université Bourgogne-Europe, président de la Fondation pour la mémoire de la déportation, président du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri.
L’Humanité, le 14 avril 2025.
Lire sur le site du journal
Avril-mai 1945, les derniers camps sont découverts par les armées alliées. Le monde commence alors à mesurer la dimension macabre de l’entreprise nazie, mais aussi la solidarité et la résistance des déportés. Les survivants demandent justice et mémoire.
La fin des camps, rendue possible par l’effondrement de l’armée allemande devant l’action conjuguée des armées alliées, fut dramatique. Rappeler ces faits quatre-vingts ans après reste indispensable si l’on veut comprendre et se souvenir de ce qu’a représenté la déportation dans ses différentes dimensions.
C’est la raison pour laquelle il semble préférable de parler de la fin plutôt que de la libération ou l’ouverture des camps. Il a fallu attendre le printemps 1945 pour en finir avec le système concentrationnaire que les nazis avaient développé depuis leur arrivée au pouvoir et leur domination sur l’Europe. Au cours de ce processus, des centaines de milliers de déportés sont décédés en particulier dans le cadre des évacuations des camps par les nazis, les « marches de la mort ».
Les différents camps et centres de mise à mort installés et administrés par les grands offices centraux du Reich, placés sous l’autorité de Himmler, ont fait partie d’un dispositif répressif dont le développement a accompagné l’extension du IIIe Reich, en Allemagne puis dans l’Europe occupée.
Effacer les traces des crimes nazis
En 1944 et au début de 1945, devant l’avancée des troupes soviétiques, les dirigeants nazis s’efforcent de vider les camps et d’effacer les traces des centres d’extermination – installés depuis 1942 dans les territoires de l’Est. Ainsi une grande partie des déportés évacués des camps d’Auschwitz arrivent dans les camps de l’Ouest situés en Allemagne dans un état sanitaire épouvantable, au terme d’un périple meurtrier.
En mars-avril 1945, les dirigeants nazis sont animés de préoccupations successives et contradictoires, puisqu’ils tentent jusqu’au bout de maintenir l’effort de guerre et le travail forcé des détenus, de marchander le sauvetage de déportés, tout en s’efforçant d’effacer les traces de leurs méfaits. Les bombardements alliés des voies ferrées, des zones industrielles liées aux camps, comme l’avancée des troupes, américaines et britanniques à l’Ouest, et soviétiques à l’Est, aggravent une situation dont la population concentrationnaire est également victime.
Les milliers de cadavres et de mourants que les soldats américains et britanniques découvrent en pénétrant dans les camps-mouroirs comme celui de Bergen-Belsen, d’Ohrdruf ou de Nordhausen ou dans les camps de Buchenwald et Dachau, constituent une vision d’horreur dont la presse internationale va se faire largement l’écho. La stupeur est d’autant plus forte que la population allemande a, sauf exception admirable, assimilé la propagande nazie présentant les déportés épuisés qui traversent villes et villages comme de dangereux bandits.
Les images des jeunesses hitlériennes amenées par les armées alliées devant les wagons remplis de cadavres, comme celles des habitants de Weimar devant les charniers et fosses communes du camp de Buchenwald, publiées par la presse internationale et les actualités filmées, suscitent désormais l’opprobre international. Elles confèrent au combat contre le nazisme une dimension éthique qui s’affirme, à l’heure du suicide d’Hitler et de la capitulation des dirigeants nazis. L’Organisation des Nations unies tient sa session inaugurale à San Francisco.
Le difficile retour des survivants
Pour les survivants le chemin du retour fut plein d’embûches, d’autant qu’ils sont dans un état physique déplorable et que l’organisation de leur rapatriement, pour les Français, est difficilement organisée. Notons que nombre de déportés ne souhaitent pas nécessairement revenir dans le pays où ils ont été raflés et persécutés avec l’assentiment des collaborateurs. Le fait d’avoir retrouvé la liberté n’a pas signifié la fin d’un parcours dramatique marqué souvent par un retour et un accueil difficile.
Parmi les survivants, ceux qui ont participé à la solidarité et à la résistance dans les camps, contrairement à la légende du grand silence, s’engagent dans une démarche de témoignage et d’information pour demander justice au nom de leurs camarades disparus, en particulier dans le cadre des associations et des amicales créées dès 1945.
Une rencontre prévue le 28 avril reviendra sur ces différentes questions en s’appuyant sur la publication récente de témoignages de ces survivants des camps dont le parcours antifasciste mérite d’être connu. Ce sera également l’occasion d’évoquer, sur la base d’expériences, comment on peut enseigner aujourd’hui l’histoire de l’antisémitisme et du racisme.