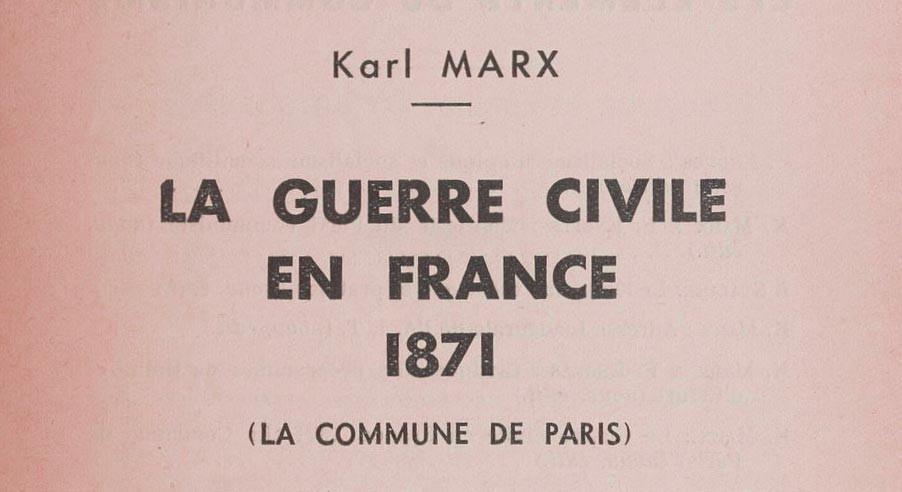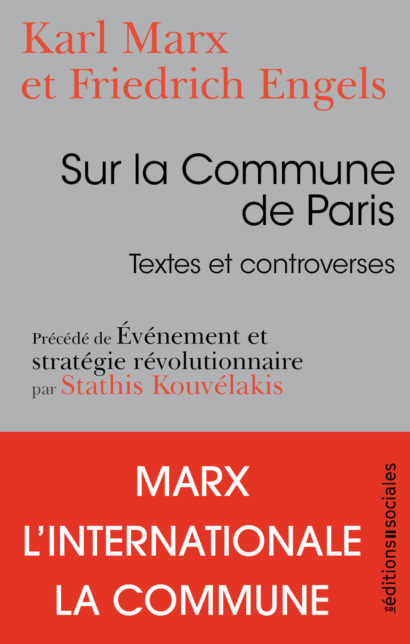Karl Marx, La Guerre civile en France, 1871
Adresse du Conseil général de l’Association internationale des travailleurs
À tous les membres de l’Association en Europe et aux États-Unis
Présentation par Florian Gulli
agrégé de philosophie, enseignant au lycée à Besançon.
La guerre civile en France est une Adresse de l’Association Internationale des Travailleurs fondée en 1864. Marx, l’un de ses principaux dirigeants, rédige le texte, rédaction qui sera approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil Général de l’AIT, le 30 mai 1871. La guerre civile en France est donc une analyse «à chaud» des événements, une analyse «impliquée» conduite par Marx, mais dans le cadre d’une organisation ouvrière.
Dans cet extrait, Marx expose «la multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise ». Toutes ces interprétations de la Commune, dont Marx dresse la liste dans ce texte, ne voient dans celle-ci que «la réplique des formes plus anciennes […] de la vie sociale». La Commune ne serait donc qu’une répétition, est-ce à dire qu’elle ne fut qu’une farce? En réalité, ces interprétations manquent le «véritable secret» de la Commune, sa radicale nouveauté. Elles pensent la Commune comme la réactualisation d’anciennes formes gouvernementales et étatiques, alors qu’elle a commencé par «briser la forme d’État moderne», alors que se manifestait en elle la volonté des masses populaires de reprendre leurs affaires en main, de mettre en place un gouvernement de la classe ouvrière qui rende à la société «les forces jusque-là absorbées par l’État».
Extrait tiré de Karl Marx, Friedrich Engels, Sur la Commune de Paris. Textes et controverses, Paris, Éditions sociales, 2021, p. 179-179.
C’est en général le sort des créations historiques entièrement nouvelles d’être prises à tort pour la réplique des formes plus anciennes, et même éteintes, de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent offrir une certaine ressemblance. Ainsi, on se méprit sur cette nouvelle Commune, qui brise le pouvoir d’État moderne, qu’on assimila à une réplique des communes médiévales, qui ont d’abord précédé ce pouvoir d’État, pour en devenir par la suite le substrat. La Constitution communale a été prise à tort pour une tentative de rompre en une fédération de petits États, conforme au rêve de Montesquieu et des Girondins, cette unité des grandes nations, qui, bien qu’engendrée à l’origine par la violence politique, est maintenant devenue un puissant facteur de la production sociale. L’antagonisme entre la Commune et le pouvoir d’État a été pris à tort pour une forme excessive de la vieille lutte contre l’excès de centralisation. Des circonstances historiques particulières ont pu empêcher dans d’autres pays le développement classique de la forme bourgeoise du gouvernement, comme il s’est fait en France, et permis, comme en Angleterre, de compléter les grands organes centraux de l’État par des conseils paroissiaux (vestries) corrompus, des conseillers municipaux affairistes et de féroces administrateurs de l’Assistance aux pauvres dans les villes et, dans les comtés, par des magistrats quasiment héréditaires. La Constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu’alors absorbées par l’État parasite qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement. Par cet acte unique, elle eût initié la régénération de la France. La bourgeoisie provinciale française vit dans la Commune une tentative de restaurer la domination que cette classe avait exercée sur la campagne sous Louis-Philippe, et qui, sous Louis Napoléon, avait été supplantée par la prétendue domination de la campagne sur la ville. En réalité, la Constitution communale plaçait les producteurs ruraux sous la direction intellectuelle des chefs-lieux des départements et leur apportait l’assurance d’y trouver, chez les travailleurs des villes, les garants naturels de leurs intérêts. L’existence même de la Commune impliquait, comme une évidence, la liberté municipale au niveau local, mais non comme un contrepoids au pouvoir d’État, désormais supplanté. Il ne pouvait venir qu’au cerveau d’un Bismarck, qui, quand il n’est pas absorbé par ses intrigues de sang et de fer, reviendrait volontiers à son ancien métier, si bien adapté à son calibre mental, de collaborateur au Kladderadatsch[1], il ne pouvait venir qu’à un tel cerveau l’idée de ramener les aspirations de la Commune de Paris à cette caricature de la vieille organisation municipale française de 1791 qu’est le régime municipal prussien, qui rabaisse les mairies au rang de simple rouage de second ordre de la machine policière de l’État prussien. La Commune a réalisé ce mot d’ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant ses deux grandes sources de dépenses : l’armée permanente et le fonctionnarisme d’État. Son existence même supposait la non-existence de la monarchie qui, en Europe du moins, est le fardeau normal et l’indispensable masque de la domination de classe. Elle fournissait à la république la base d’institutions réellement démocratiques. Mais ni le « gouvernement à bon marché » ni la « vraie république » n’étaient son but dernier ; ils n’étaient guère que ses corollaires.
La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise et la multiplicité des intérêts qui se réclamaient d’elle montrent que c’était une forme politique éminemment expansive, alors que toutes les formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement répressives. Son véritable secret, le voici : c’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le produit de la lutte de classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin découverte sous laquelle pouvait se mener l’émancipation économique du travail.
Pour en savoir lire Sur la Commune de paris à commander sur le site des Editions sociales.
[1]Journal satirique de Berlin.