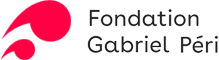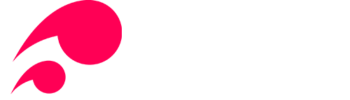Par Jean-Pierre Le Crom
Directeur de recherche émérite au CNRS
Nous reproduisons avec l’accord de l’auteur et de la revue Droit social, que nous remercions vivement, un extrait de l’article « Aux origines de la Sécurité sociale, retour sur un sujet controversé », à paraître en octobre 2025 dans un dossier consacré aux 80 ans de la Sécurité sociale.
« Quand l’armée allemande envahit la France en juin1940, la France possède sinon un système du moins des dispositifs de protection sociale. À côté de l’assistance publique, accordée à certaines catégories de la population sans contrepartie, à côté aussi des mutuelles et de la prévoyance privée ou familiale, des dispositifs obligatoires sont institués progressivement en matière d’accidents du travail (loi de 1898), de retraites (loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes [ROP]), d’assurances sociales (lois de 1928 et 1930) et d’allocations familiales (loi de 1932). Le risque chômage n’est quant à lui pris en charge que sur un mode assistanciel, donc sans contrepartie, par les communes ou les départements.
Les limites de ce système sont patentes. À l’exception sans doute des allocations familiales, les prestations sont insuffisantes. Il faut par exemple avoir cotisé soixante jours au moins lors du trimestre précédent la survenue de la maladie pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance maladie. Le remboursement des médicaments est limité à 25 francs et le tarif de responsabilité servant de base au remboursement des soins médicaux et d’hospitalisation est souvent beaucoup plus bas que le tarif effectivement pratiqué par les médecins ou les hôpitaux.
En matière d’accidents du travail, dont l’assurance constitue un juteux marché pour les compagnies privées, de nombreux petits employeurs ne souscrivent pas de police, l’assurance n’étant pas obligatoire. Les fonds de garantie créés par l’État ne permettent pas de régler le problème. Par ailleurs, le principe de la réparation forfaitaire ne permet pas une indemnisation à hauteur du préjudice subi.
Les retraites sont quant à elles extrêmement faibles. En 1945, elles ne dépassent pas en moyenne 20 % du salaire moyen.
La gestion des risques est effectuée de manière très disparate et sans cohérence. Les assurances sociales sont gérées par des caisses dites d’affinité – patronales, syndicales, mutualistes, familiales… – dans lesquelles les assurés peuvent s’inscrire selon leur préférence. Il existe aussi des caisses neutres, d’ailleurs majoritaires. En 1944, on dénombre ainsi 589 caisses primaires pour les risques maladie et maternité, plus soixante-huit caisses vieillesse et quinze unions régionales. Il existe bien une caisse générale de garantie, établissement public institué pour compenser les charges, mais elle n’a aucun pouvoir hiérarchique sur les caisses.
Les caisses d’allocations familiales (CAF) souffrent également de grandes disparités. Leur cadre géographique est disparate ; elles peuvent être professionnelles ou interprofessionnelles ; surtout les taux de cotisation varient fortement selon les professions ou même les entreprises. En 1944, les écarts de taux peuvent osciller entre 4 % et 28 % des salaires.
Il existe aussi un réel problème de représentation des salariés dans les conseils d’administration des diverses instances : les CAF sont exclusivement gérées par des représentants du patronat, qui est le seul à financer les prestations ; la gestion des accidents du travail est aux mains de compagnies privées émanant souvent de grands groupes capitalistes ; les caisses d’assurances sociales sont principalement tenues par des mutualistes qui sont rarement des salariés mais proviennent plutôt des classes moyennes.
Pour compléter ce sombre tableau, on n’oubliera pas de mentionner que les non-salariés – agriculteurs, indépendants… – qui représentent environ quatre actifs sur dix, n’ont pratiquement pas de couverture sociale. Cette situation est bien connue, mais les tentatives de réforme échouent généralement, souvent en raison de l’opposition du Sénat.
Quand le maréchal Pétain devient chef de l’État en juillet 1940, il désigne Pierre Laval comme vice-président du Conseil. Celui-ci va alors chercher René Belin pour occuper les fonctions de ministre de la Production industrielle et du Travail. Dans un contexte très difficile – la moitié de la France est occupée par les Allemands ; il y a deux millions de réfugiés et à peu près autant de chômeurs –, ce syndicaliste anticommuniste considéré quelquefois comme le numéro 2 de la CGT, entreprend une série de réformes qui cherchent à la fois à répondre aux problèmes particuliers du moment tout en s’inscrivant dans la fameuse Révolution nationale souhaitée par Pétain. Par une loi d’août 1940 sur la production industrielle, il crée les comités d’organisation, entame par ailleurs une refonte de l’organisation des relations professionnelles qui n’aboutira qu’en octobre 1941, après moults péripéties, avec la Charte du travail, et élabore un projet de réforme des assurances sociales.
Pour l’aider dans cette tâche, Belin fait appel à Pierre Laroque, membre du Conseil d’État jusqu’alors mobilisé, bon connaisseur du droit social pour avoir notamment rédigé un rapport remarqué sur les conventions collectives pour le Conseil national économique en 1934 et qu’il avait sans doute croisé dans les milieux planistes dans les années précédentes. Il ne sera membre du cabinet qu’entre août et le 14 décembre 1944, date à laquelle il est limogé du Conseil d’État en raison de ses prétendues origines juives, et avant de rejoindre un peu plus tard la Résistance gaulliste à Londres. Pierre Laroque est assez peu disert, notamment dans ses mémoires, sur cette période de sa vie professionnelle. Il ne s’intéresse pas ou peu à ce qui deviendra la charte du travail même s’il lui consacre un article anonyme dans la revue Droit social en janvier 1942. Il est par contre très actif dans la préparation de la loi du 16 août 1940 sur les comités d’organisation et dans celle relative aux assurances sociales.
Il reste des incertitudes sur les rédacteurs de ce projet dit Belin qui prévoit une réforme des assurances sociales, des allocations familiales et des congés payés qu’on trouve notamment dans les archives de la Caisse des dépôts et consignations. Même s’il n’en parle pas dans ses mémoires, il semble évident que Pierre Laroque, accompagné sans grand doute de l’actuaire Francis Netter, y a apporté sa contribution, s’il ne l’a pas rédigé lui-même. Ce projet prévoit trois grandes modifications :
— l’extension des assurances sociales à l’ensemble des salariés ;
— l’institution d’une allocation à toute personne âgée de soixante ans ou plus ou ayant travaillé plus de trente ans et touché jusqu’à 13 000 francs annuels. Financée par un prélèvement sur les réserves accumulées par les caisses de capitalisation, cette allocation est envisagée sur le mode de la répartition ;
— le regroupement des caisses d’assurances sociales, d’allocations familiales et de congés payés dans des caisses uniques, départementales ou nationales.
Ce projet va être vivement critiqué, à l’extérieur comme à l’intérieur du gouvernement de Vichy, principalement sur le sujet du regroupement des caisses. Le général de Castelneau, président de la puissante Fédération nationale catholique, écrit ainsi : « Substituer dans chaque département, une seule et colossale administration d’État des assurances sociales aux caisses diverses aujourd’hui existantes est une conception socialiste et fonctionnariste éminemment contraire à l’esprit social et charitable qui doit animer les organisations d’assurances sociales. Ceux-ci [sic] ne sont pas des bureaux et des guichets où des bureaucrates paient des assujettis inconnus, mais ils sont des œuvres sociales où des hommes de bien (directeurs de caisse, chefs de bureau, médecins) et des femmes expérimentées (assistantes sociales, infirmières visiteuses, etc.) viennent en aide à des hommes, des femmes, des enfants, qu’ils s’efforcent de connaître individuellement et d’aider moralement et matériellement. Cette conception se réalise dans les caisses privées, grâce à l’esprit qui les anime et au nombre relativement restreint de leurs adhérents. Elle ne le sera pas dans l’immense building administratif qu’il faudra édifier à grands frais dans chaque département ». Ces idées sont également celles de la Mutualité et elles sont reprises à l’intérieur du gouvernement, notamment par Bouthillier, le ministre des Finances. La force des oppositions est telle que le projet est abandonné. Belin tentera bien de le ressortir en 1942, mais à nouveau sans succès. L’extension des assurances sociales à l’ensemble des salariés aura un début de réalisation avec la loi du 6 janvier 1942 qui prévoit l’affiliation de tous les ouvriers, sans plafond de rémunération. La loi du 22 mai 1946 portant généralisation de la sécurité sociale aura une ambition plus large puisqu’elle visera « tout Français résidant sur le territoire de la France métropolitaine », mais on sait que cette ambition ne sera que partiellement réalisée.
La partie du projet consacrée aux retraites va quant à elle être réellement mise en œuvre avec la création de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) par la loi du 14 mars 1941. Cette allocation, dont l’objectif principal est de dégager les vieux d’un marché du travail en proie à un chômage massif, est financée par le prélèvement des avoirs déjà encaissés par les caisses sur le mode de la capitalisation, désormais remplacé par celui de la répartition. D’un faible montant de 3 000 F ou 4 500 F pour un ménage, ce qui permet d’acheter trois œufs par jour, et sous conditions (il faut être Français, avoir travaillé pendant cinq ans avant et disposer d’un maximum de ressources), l’AVTS sera servie à jusqu’à 1 650 000 personnes en 1944, 975 000 n’ayant jamais rien cotisé aux Retraites ouvrières et paysannes (ROP) ou aux Assurances sociales.
Les réserves puisées dans celles-ci s’avèreront donc insuffisantes pour en assurer le paiement et, en 1945, il sera nécessaire d’instaurer un prélèvement spécifique de 4 % sur les entreprises pour combler le déficit.
Il existe donc bien des homologies entre le plan Belin de 1940 et le plan Laroque de 1945. Elles s’expliquent d’abord par la nature politique du régime de Vichy, qualifié de « dictature pluraliste » par Robert Paxton ou de « dictature plurielle » par Denis Peschanski. Cette pluralité est particulièrement prononcée dans le domaine des politiques sociales, disputées entre des modernistes incarnés ici par la figure de l’ancien cégétiste René Belin et des traditionalistes qui se manifestent bruyamment au gouvernement, auprès de la vice-présidence du Conseil ou au cabinet du chef de l’État français. Elle est également manifeste en droit du travail, avec la préparation et la mise en œuvre de la Charte du travail.
Cette volonté « réformatrice » ne résistera pas bien longtemps au durcissement du régime et à l’opposition persistante entre « vieux romains » et « jeunes cyclistes ». Au bout du compte, la protection sociale ne connaîtra pas de changements substantiels pendant le régime de Vichy, à part peut-être la création de l’AVTS. Cependant, des tendances lourdes déjà à l’œuvre auparavant sont manifestes, comme l’élargissement du nombre de bénéficiaires qui passe, pour les assurances sociales, de 11,4 millions à 15,7 millions en cinq ans et le gonflement corrélatif des charges sociales, qui représentent 30 % du montant des salaires en 1943 (et 14,4 % du revenu national) contre 25,9 % en 1939 (et 11,4 % du revenu national).
Cette augmentation du « second salaire », pour reprendre une expression du résistant et futur ministre Albert Gazier, doit aussi beaucoup, et principalement, pour cette période de guerre, au blocage des salaires et à la volonté des pouvoirs publics, du ministère du Travail en particulier, de favoriser l’accroissement des revenus de salaire indirect, ce qui explique aussi l’indéniable réussite des comités sociaux d’entreprise, souvent appelés « comités patates », en raison de leur rôle en matière de ravitaillement. »
Bibliographie
Dreyfus (Michel), Ruffat (Michèle), Viet (Vincent) et Voldman (Danièle), avec la collaboration de Bruno Valat, Se protéger, être protégé. Une histoire des assurances sociales en France, Presses universitaires de Rennes, 2006, 347 p.
Dreyfus (Michel), Les mutualistes à l’épreuve de la guerre (1939-1945), Arbre bleu éditions, 2021, 228 p.
Hesse (Philippe-Jean) et Le Crom (Jean-Pierre) (dir.), La protection sociale sous le régime de Vichy, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2001, 388 p.
Jabbari (Éric), Pierre Laroque and the Welfare State in Postwar France, Oxford, Oxford University Press, 2012, 188 p.
Laroque (Pierre), Au service de l’homme et du droit : souvenirs et réflexions, Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1993, 376 p.
Le Crom (Jean-Pierre), « Penser la protection sociale sous Vichy : le poids du passé, le choc des événements », in Clément Benalbaz Charles Froger, Sébastien Platon et Bruno Berthier (dir.), L’œuvre législative sous Vichy, d’hier à aujourd’hui. Ruptures et continuités, Paris, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2017, p. 163-175.
Leclerc (Pierre), La sécurité sociale, son histoire à travers les textes, Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, tome 2 (1870-1945), 1996, 784 p.
Valat (Bruno), Histoire de la sécurité sociale (1945-1967). L’État, l’institution et la santé, Economica, 2001, 544 p.
Valat (Bruno), « Résistance et sécurité sociale (1941-1944) », Revue historique, n° 592, oct.-déc. 1994, p. 315-346.