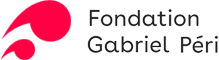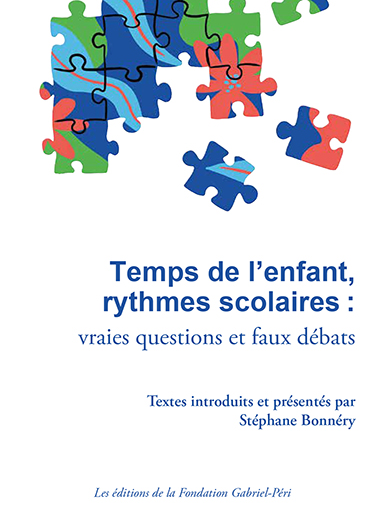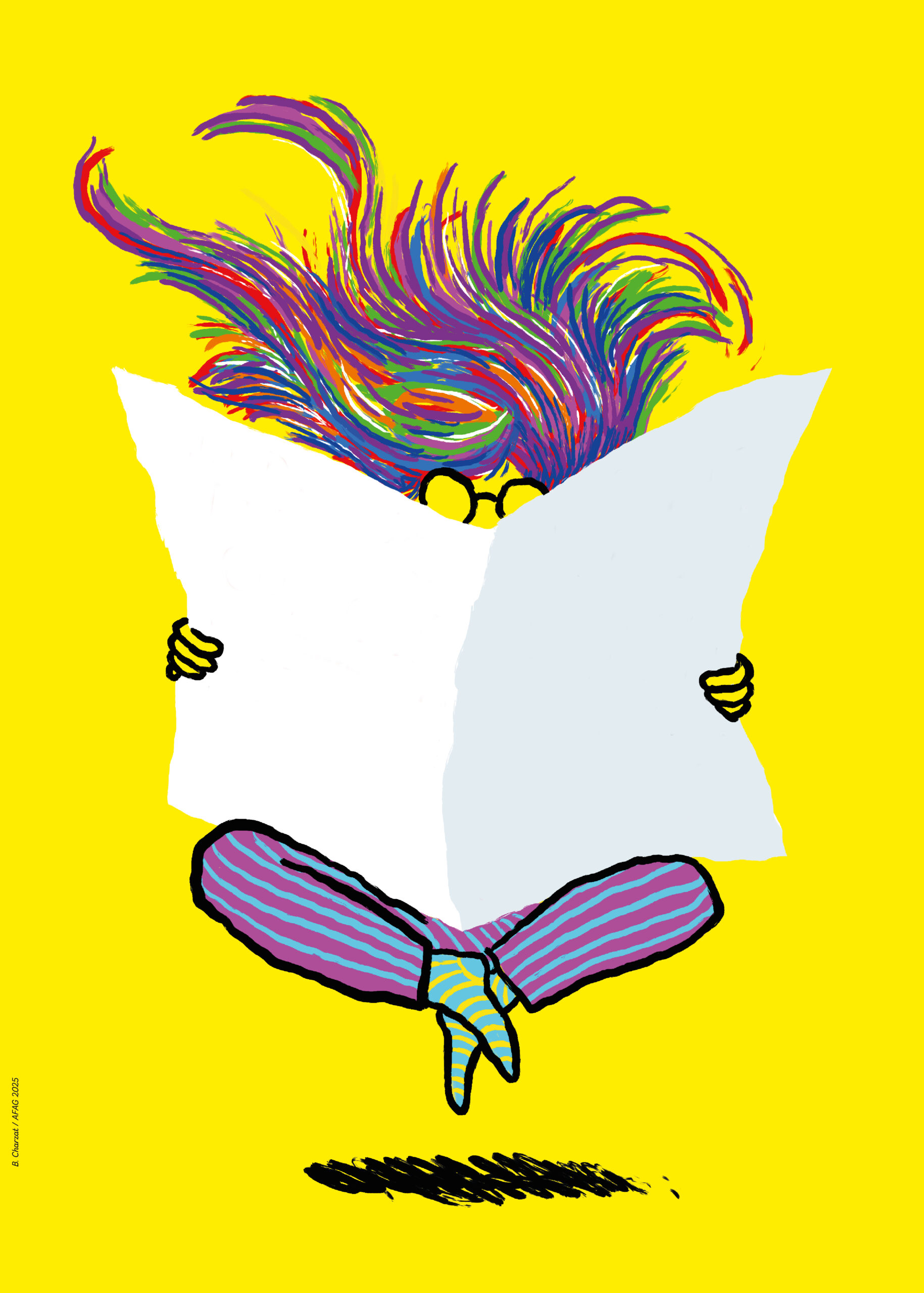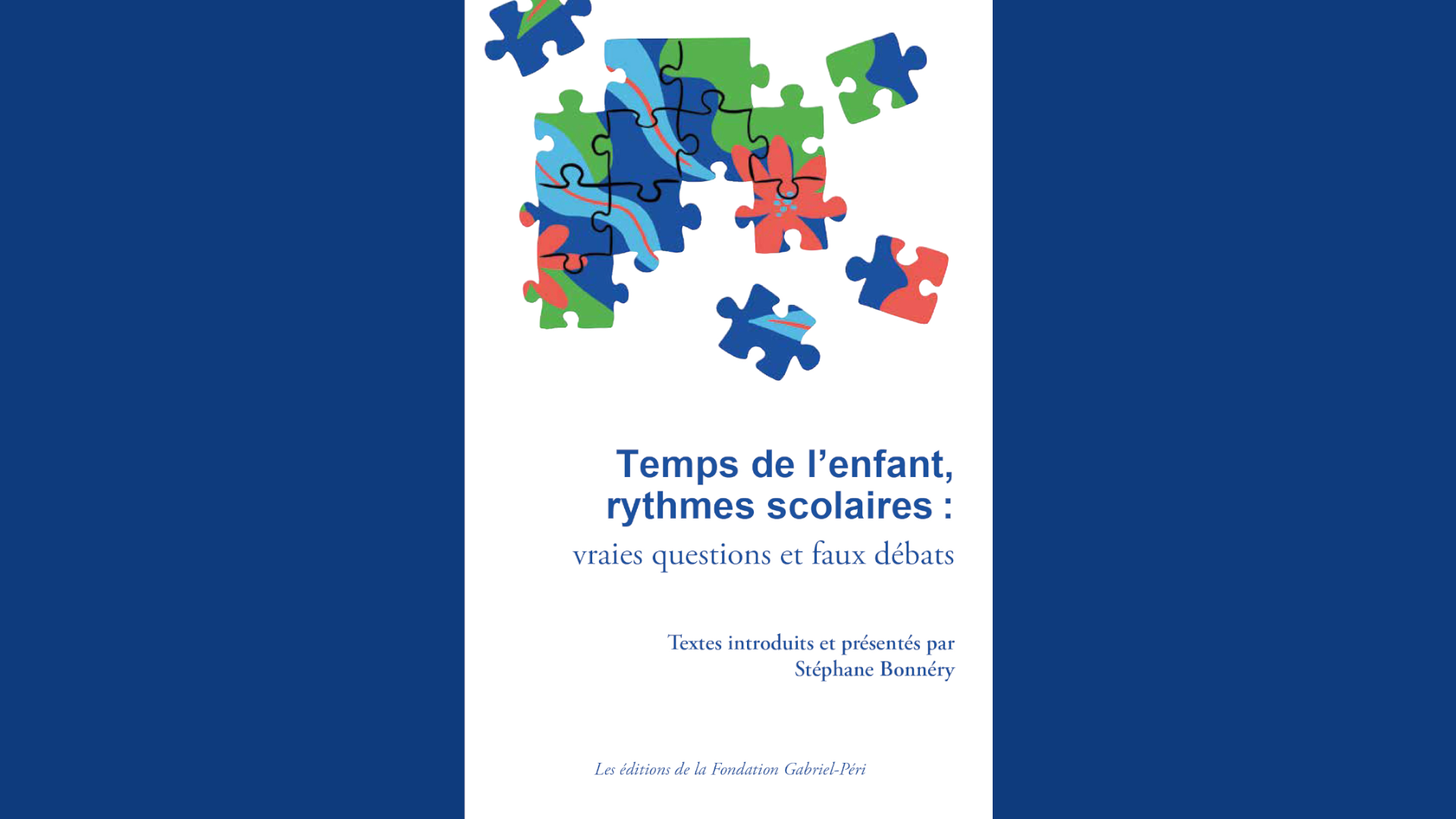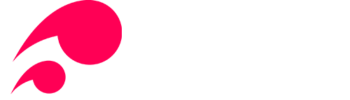Entretien avec Stéphane Bonnéry, professeur en sciences de l’éducation à Paris VIII, directeur de la revue La Pensée et membre du Conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, réalisé par Hélène May.
L’Humanité, le 16 février 2025.
Lire sur le site du journal
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur publie des évaluations très critiques sur un certain nombre de formations en licence et en master qui reçoivent davantage d’étudiants issus des catégories populaires. Le chercheur Stéphane Bonnéry alerte sur leurs conséquences.
Pourquoi tirez-vous la sonnette d’alarme ?
Nous sommes très inquiets. Les résultats des évaluations des diplômes de licences et masters, qui sont tombés le 14 février, montrent une proportion anormalement importante de ces formations, parfois jusqu’à la moitié d’entre elles, ayant reçu un avis défavorable ou réservé de la part du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).
Cette vague d’évaluations défavorables concerne les universités d’Île-de-France hors Paris, des Hauts-de-France, de Mayotte et de la Réunion, soit des universités implantées dans des milieux peu favorisés. Il s’agit d’une attaque politique et idéologique. Cela pourrait aboutir à la fermeture des formations critiquées, via une baisse de financement ou un refus d’ouverture de postes. Cela pourrait aussi nous obliger à mettre en œuvre des mesures contraires à ce que nous estimons nécessaire à la qualité de formation.
En quoi consistent ces évaluations ?
Tous les cinq ans, chaque université est évaluée à trois niveaux : ses laboratoires de recherche, ses écoles doctorales et ses diplômes de licences et masters. En apparence indépendant, le HCERES est en fait un organisme paragouvernemental fermement tenu par la tutelle politique.
Cela se ressent surtout dans l’évaluation des formations, où il peut choisir les évaluateurs de son choix alors que pour les laboratoires et les formations doctorales, il est contraint de faire appel à des experts reconnus de la discipline concernée. Cela aboutit à ces résultats paradoxaux : alors que les laboratoires des universités évalués lors de cette vague ont reçu des notes très favorables, les masters, qui forment pour ces mêmes laboratoires, ont été jugés mauvais.
Au-delà de cette critique, pourquoi contestez-vous ces évaluations ?
Nous contestons les critères utilisés. On nous reproche ainsi d’avoir trop d’enseignants vacataires en licence, alors que les contraintes budgétaires de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU, dite loi Pécresse), qui a contraint les universités a devenir indépendantes financièrement, empêchent de recruter des titulaires.
Autre point, le HCERES critique le taux d’échec dans ces formations. Mais il se base sur un tableau Excel, sans prendre en compte les facteurs explicatifs. Le profil social des élèves est totalement ignoré, tout comme « l’effet Parcours sup », qui draine les bons élèves hors des universités de banlieue, ou au contraire y place par défaut des élèves mal orientés qui les quittent pour se réorienter.
C’est pareil pour le taux d’insertion dans l’emploi. Il n’est pas du tout tenu compte du fait que lorsqu’on habite Amiens ou La Courneuve, les possibilités de trouver un emploi au sortir du diplôme ne sont pas les mêmes que lorsqu’on étudie dans l’Ouest parisien. Le HCERES fustige aussi le manque de mobilité internationale des étudiants de ces licences et masters. Là encore, c’est cynique. C’est un déni du fait que nombre de nos étudiants sont soutiens de famille, travaillent à côté de leurs études, et n’ont pas les moyens de partir à l’étranger.
Quelle est la signification politique de ces évaluations ?
Il s’agit d’une offensive pour vider l’université publique des filières les moins idéologiquement « respectables », c’est-à-dire les moins formatrices de personnes destinées à fabriquer de la valeur marchande à court terme. Cela s’inscrit dans la remise en cause de la démocratisation scolaire et du consensus qui a prévalu pendant 50 ans selon lequel tout le monde, quelle que soit son origine sociale, allait étudier plus longtemps.