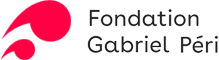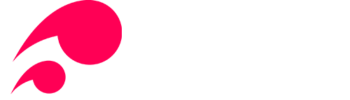IL Y A 30 ANS, LA SECU (encore) ATTAQUEE !
Bernard Thibault
Secrétaire général de la fédération des cheminots en 1995
À l’automne 1995, dans un climat social déjà tendu, l’une des plus fortes mobilisations sociales qu’ait connue le pays depuis 1968 se construisait contre le « plan Juppé » qui réformait en profondeur le pilotage et les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale, d’une part, et le contrat de plan État /SNCF qui définissait les moyens financiers et les orientations stratégiques pour la SNCF pour les cinq prochaines années, d’autre part. Retour avec Bernard Thibault, Secrétaire général de la fédération des cheminots à cette époque et figure de proue du mouvement, sur le contexte et le contenu de ces réformes, sur les raisons qui expliquent le succès de la mobilisation et sur des enseignements à tirer.
Éléments de contexte
Dans « l’histoire de la SÉCU » et des luttes sociales pour la défendre, l’année 1995 occupe une place particulière. Par l’ampleur de l’attaque gouvernementale pilotée à ce moment-là par le Premier ministre de l’époque, Alain Juppé, mais surtout par la réaction et la mobilisation considérable d’une majorité de Français pour dire STOP, trop, c’est trop !
Sur le plan politique, l’année 1995 est une année d’élection présidentielle. Jacques Chirac est élu en mai pour succéder à François Mitterrand. Il a notamment fait campagne sur le thème de « la fracture sociale » cherchant ainsi à faire écho au pessimisme ambiant alimenté par un contexte économique morose et une conflictualité sociale déjà bien présente. Le taux de chômage est officiellement autour de 12% et la précarité dans l’emploi progresse. Le pouvoir d’achat est en baisse, la consommation des ménages est atone, de nombreux conflits éclatent dans l’industrie comme chez Renault. Le secteur public est malmené, objet de restructurations et de réductions de crédits dans tous les domaines : poste, hôpitaux, éducation nationale… Déjà au printemps, les étudiants manifestent pour avoir les moyens de leurs études. Au fil des mois, il apparait très vite qu’il y a « tromperie sur la marchandise ». L’ampleur des déficits publics et les contraintes de l’intégration européenne amènent le pouvoir en place à prendre une série de mesures drastiques présentées, comme à l’habitude, pour le bien des Français et des générations futures. « La fracture sociale » passe aux oubliettes.

Une de La Vie ouvrière, n°2674/113, 24-30 novembre 1995 © IHS-CGT
À l’automne, deux réformes se télescopent :
L’une dit « plan Juppé » prétend réformer en profondeur le pilotage et les droits des travailleurs en matière d’assurance maladie, de retraite et de prestations sociales :
- Instauration d’un droit du parlement pour limiter les dépenses de santé.
- Augmentation des cotisations maladie pour les retraités et chômeurs.
- Blocage et imposition des allocations familiales.
- Allongement de la durée de cotisation pour accéder à la retraite pour les agents de la fonction publique et suppression des régimes spéciaux de retraite (au nom d’un alignement sur la réforme Balladur de 1993 des retraites pour le secteur privé).
- Création d’un nouvel impôt (RDS) pour « rembourser la dette sociale …
L’un des piliers qui participent à la cohésion sociale, issu du programme de CNR est ainsi brutalement remis en cause.
L’autre réforme « le contrat de plan État /SNCF ». Ce contrat doit être signé avant la fin 95. Il doit définir les moyens financiers et les orientations stratégiques pour la SNCF pour les cinq prochaines années.
Menées pendant de longs mois dans le plus grand secret malgré les nombreuses mobilisations de tous les syndicats exigeant la transparence sur le devenir d’un service public « qui appartient à la nation », les arbitrages gouvernementaux aboutissent aux perspectives :
- D’une baisse de la masse salariale à la SNCF ;
- d’une diminution des effectifs de l’ordre de 30 000 emplois sur 5 ans ;
- de l’augmentation de la productivité de 5,5%/an (soit 4 fois plus) ;
- de la fermeture de 6 000 km de lignes soit près d’un tiers du réseau ferré jugé insuffisamment rentable financièrement.

Cheminots en manifestation à Paris © Photographie de Guy Poitou. Coll. IHS-CGT cheminots, Fi 52/14.
Une mobilisation qui vient de loin
Les événements qui vont suivre feront regretter au gouvernement, mais un peu tard, de ne pas avoir su apprécier le climat social et surtout la portée de ses projets qui allaient susciter l’une des plus fortes mobilisations qu’ait connue le pays depuis 1968. Dans un premier temps, le gouvernement avait, à son corps défendant, de quoi être optimiste s’il ne s’en remettait qu’aux commentaires de presse. Une enquête du Nouvel Obs relevait que 60% des médias présentaient favorablement le plan Juppé de réforme de la Sécurité sociale ! La messe était dite ! Et bien non, ça ne se passera pas comme ça !
Les cheminots tout d’abord étaient préparés et organisés pour la confrontation. Non pas qu’ils la recherchaient par principe, mais parce que depuis de nombreuses années déjà, ils subissaient, et les usagers avec eux, les effets d’une remise en cause systématique de leur mission de service public par un État défaillant ne privilégiant que le « tout TGV ». Par une démarche syndicale unitaire inédite, portée à bout de bras par la fédération CGT des cheminots, qui s’est amplifiée dès les premières années 90, les personnels de toutes catégories avaient multiplié les initiatives, les grèves et les manifestations pour alerter les élus et la population sur la dégradation de la situation et les nouveaux risques pour l’avenir. Manifestations à Paris, pétition nationale, rencontres des élus locaux, travail en commun avec les associations d’usagers, les maires… Tout ce travail n’aura pas fait bouger la direction de la SNCF et les services de l’État pendant de longs mois. Il a été cependant déterminant pour la suite, pour qu’à l’heure dite, la compréhension des enjeux soit plus largement partagée.

Cheminots en manifestation à Paris © Photographie de Guy Poitou. Coll. IHS-CGT cheminots, Fi 52/14.
C’est ainsi qu’après ces annonces et l’ignorance des précédents avertissements de la profession, c’est tout à fait logiquement que la CGT cheminots puis l’ensemble des autres fédérations décidaient de s’inscrire dans la journée de grève déjà prévue dans la fonction publique le 24 novembre. Fait inédit, toutes les fédérations accompagnaient cet appel par la convocation d’assemblées générales des personnels, organisées ensemble pour décider des conditions de poursuite de l’action pour les jours suivant, compte tenu de l’ampleur des attaques dont la profession était l’objet avec le plan Juppé et le contrat de plan. La double peine en quelque sorte. Après une énorme participation à la grève du 24, comme une trainée de poudre, les décisions de poursuivre la grève les jours suivant se multiplient dans tous les départements. Ce sera le cas pendant au moins 21 jours au cours desquels aucun train ne circulera sur le réseau. De source SNCF (pour ne pas dire policière !), le taux de gréviste moyen sera de 70%. Près de 80% pour les ouvriers et employés, 60% pour la maitrise et fait exceptionnel plus de 30% pour les cadres. La mobilisation s’installe dans la durée et s’élargit progressivement. Principalement ancrée dans le secteur public et la fonction publique, la grève se répand à la poste, dans l’Énergie, à l’éducation nationale, à la RATP… Selon les rapports de force, des modalités variables sur chaque site installent le mouvement dans la durée. Six grandes journées de manifestations interprofessionnelles viendront ponctuées les semaines qui suivront permettant ainsi au plus grand nombre de s’impliquer. Le volume de manifestants, composé des grévistes du public et des salariés du privé, de l’industrie, du commerce… ne cessera de croître. Les étudiants sont aussi très présents. Les rares sondages d’opinion faisaient apparaitre, malgré la gêne, malgré la couverture médiatique qui reprenait au début la condamnation classique des « preneurs d’otages », que plus de 60% des Français soutenaient la grève. Alain Juppé cherchant à minimiser l’ampleur de la fronde lancera « droit dans ses bottes », « nous discuterons lorsqu’il y aura 2 millions de manifestants ! ». Ce que nous appellerons le « Juppéton » sera largement dépassé avec plus de 2 millions de manifestants le 12 décembre. En pareilles circonstances, les manœuvres de diversion ou de division ne manquent pas. Il y aura bien la tentative d’organiser une manifestation des usagers des transports en colère, mais seuls quelques manteaux de fourrure seront réunis dans Paris manifestement peu habitués à fréquenter le métro le reste de l’année ! Certains journalistes s’étonnent de voir des travailleurs quitter leur domicile à 4h du matin pour aller au travail et être solidaires des grévistes ! Ce sont les grévistes de 95 qui ont contribué à installer le covoiturage. C’est là un autre phénomène marquant de la période donnant de la force et de la détermination à la mobilisation : la solidarité venait de tous horizons. Là des commerçants faisant un geste pour les grévistes, ailleurs des agriculteurs fournissant des piquets de grève. Et puis tous ceux, ne pouvant s’impliquer autant qu’ils l’auraient souhaité, souvent du fait de leur précarité, marquent leur engagement par une solidarité financière pour dire « je suis d’accord avec vous, tenez bon ! ». Sans que nous ayons pris d’initiative, la fédération des cheminots recevra près de 9 millions de francs de dons. Une retraitée anonyme viendra déposer une enveloppe au siège de la CGT avec quelques francs et un petit mot manuscrit « voici mon dernier remboursement de la sécu, c’est grâce à vous ! »


La problématique de l’unité syndicale
Le constat est classique : unis, les syndicats et les travailleurs sont plus forts ; dispersés voire divisés, le combat est plus difficile à conduire. Présente au départ le 24 novembre avec les salariés du public, la confédération CFDT se distinguera de la CGT et de FO en soutenant la logique et les objectifs du plan Juppé ; sa secrétaire générale, Nicole Notat, allant jusqu’à considérer que les mesures sur la sécu s’inspiraient des revendications de son syndicat ! Cette position créera naturellement des remous au sein de l’organisation au point que certains de ses membres décideront ensuite de la quitter. Assez naturellement, le gouvernement paria sur cette division pour l’emporter, pari perdu ! Pour les cheminots, l’unité de la profession et de tous leurs syndicats et la conduite du mouvement par la tenue d’assemblée générale quotidienne ont consolidé, au contraire, le slogan apparu à ce moment-là : « TOUS ENSEMBLE ! »
Quelle société pour demain ?
Au fil des jours, il est rapidement apparu que si le retrait du plan Juppé et du contrat de plan pour la SNCF était au centre des revendications, ces réformes symbolisaient un rejet plus large des politiques à l’œuvre affaiblissant les services publics, les garanties collectives et précarisant le travail.
Parmi les nombreux intellectuels qui soutenaient la grève, Pierre Bourdieu, sociologue internationalement reconnu, prononça une intervention remarquée devant les cheminots grévistes de la gare de Lyon, le 12 décembre 1995 dont voici un extrait :
« La crise d’aujourd’hui est une chance historique, pour la France et sans doute aussi pour tous ceux, chaque jour plus nombreux, qui, en Europe et ailleurs dans le monde, refusent la nouvelle alternative : libéralisme ou barbarie. Cheminots, postiers, enseignants, employés des services publics, étudiants et tant d’autres, activement ou passivement engagés dans le mouvement ont posé par leurs manifestations, par leurs déclarations, par les réflexions innombrables qu’ils ont déclenchées et que le couvercle médiatique s’efforce en vain d’étouffer, des problèmes tout à fait fondamentaux, trop importants pour être laissés à des technocrates aussi suffisants qu’insuffisant : comment restituer aux premiers intéressés, c’est-à-dire à chacun de nous, la définition éclairée et raisonnable de l’avenir des services publics, la santé, l’éducation, les transports, etc. , en liaison notamment avec ceux qui, dans les autres pays d’Europe, sont exposés aux mêmes menaces ?
Le dénouement
Il faut attendre le 10 décembre pour que le Premier ministre convienne qu’il faut lâcher du lest. Il reconnait que le dialogue n’a pas eu lieu sur le contrat de plan. Il suspend les travaux de la commission chargée de remettre en cause les régimes spéciaux de retraite du public. Il annonce la perspective de discussions avec les confédérations syndicales. Clairement, la donne commence à changer, des victoires sont à portée de main. Il faudra encore quelques jours pour obtenir les garanties écrites du gouvernement qu’exigent les cheminots grévistes. C’est pratiquement sous la dictée que, le 14 décembre, à 21h30, le ministre des Transports adresse aux fédérations professionnelles les garanties attendues : « Gel et remise à plat du contrat de plan sur le devenir de la SNCF, arrêt des restructurations ou filialisation en cours, maintien de tous les dispositifs statutaires des cheminots dans les domaines de la retraite et de protection sociale ».
Logiquement, les assemblées de cheminots décideront de faire évoluer leur forme d’engagement. Toutes les revendications professionnelles sont satisfaites, mais il demeure le plan Juppé. La grève sera progressivement levée tout en continuant à participer aux journées de manifestation interprofessionnelle comme le 16 décembre. D’aucuns considéraient, dans une forme de « grève par procuration », qu’il suffisait de déléguer à quelques secteurs clefs, comme les transports, la responsabilité de faire plier le gouvernement sur l’avenir de la sécu en continuant la grève. C’était une vision bien sûr réductrice des conditions qu’il aurait fallu réunir pour l’emporter totalement.
Ainsi, le plan Juppé a survécu aux grèves et manifestations.

Une de La Tribune des cheminots, n°728, décembre 1995 © IHS CGT Cheminots
Ils ne l’emporteront pas au paradis !
Il y a naturellement de nombreux enseignements à tirer de cet événement. Personnellement j’en retiens trois principaux:
- « Il n’y a jamais rien écrit d’avance » et pour personne. En permanence, on voudrait nous convaincre qu’il n’y a pas d’alternatives à ce qui est annoncé et parfois de manière très brutale. Il suffirait que les décideurs, en l’occurrence les gouvernants, décrètent leurs intentions et le tour est joué, le sort en est jeté. Les choses seront ainsi, peu importe les protestations, critiques, la culture du renoncement est largement diffusée. La vaste mobilisation de l’hiver 1995 aura à sa manière mis un coup d’arrêt à ce fatalisme ambiant.
- « Il faut se donner les moyens de ses objectifs ! » Les déclarations enflammées et des objectifs démesurés ne servent à rien, si l’on ne dispose pas des outils nécessaires pour mener le combat. En l’occurrence, un outil syndical rigoureux, organisé, dynamique ou chacun de ses membres compte pour un dans la longue marche syndicale
« Démocratie et unité des travailleurs sont deux piliers historiques du syndicalisme ». Une fois encore, les syndicats ont montré, en cet hiver 95, qu’ils pouvaient être de puissants leviers pour la mobilisation. Raison de plus pour les consolider à tous les niveaux et sans relâche.
Septembre 2025