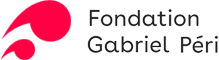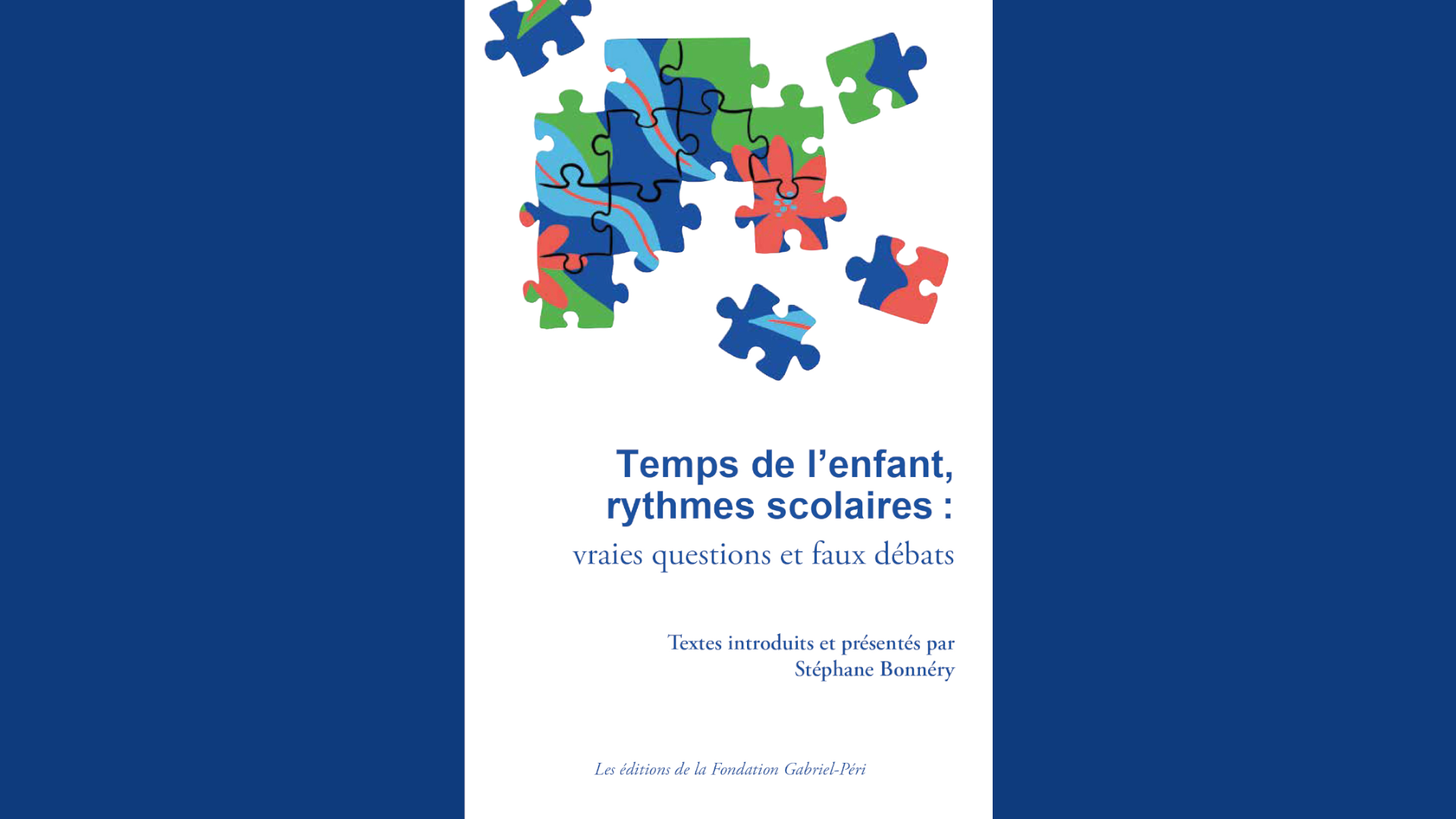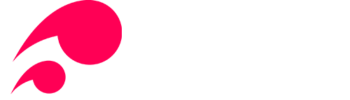Le 4 avril dernier, avec le concours de l’Institut CGT d’histoire sociale (IHS CGT), de la Société française d’histoire politique (SFHPo) et l’Association française pour l’histoire des mondes du travail, la Fondation Gabriel-Péri organisait sous le parrainage du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) un colloque à l’Assemblée nationale intitulé « Restauration ou refondation de la République » consacré à la Libération. L’Humanité a réuni trois des intervenants pour revenir sur cette période.
Entretien avec Gilles Richard, Michel Pigenet et David Chaurand, réalisé par Pierre-Henri Lab, l’Humanité, le 1er mai 2025.
Lire sur le site du journal
Période d’effervescence politique et sociale, la Libération a vu les forces de la Résistance poursuivre la guerre jusqu’à la défaite de l’Allemagne nazie tout en s’employant à édifier un modèle de société véritablement démocratique et social.
Quel est le contexte politique à l’été 1944 en France ?
Gilles Richard, historien et président de la Société française d’histoire politique.
La France n’est pas libérée le 6 juin 1944 au soir du débarquement. La Libération s’étend sur neuf mois. Les deux dernières poches allemandes, Dunkerque et La Rochelle, ne se rendent que le 9 mai 1945. Les combats font 100 000 morts. La France est dirigée par les forces de la Résistance unies derrière Charles de Gaulle.
Au sein du gouvernement provisoire de la République française (GPRF) et du Conseil national de la Résistance (CNR) se retrouvent les deux résistances, celle de l’extérieur et celle de l’intérieur. La France libre est dominée par les forces de droite tandis qu’à l’intérieur, les forces de gauche sont majoritaires.
Ces forces partagent le même objectif de gagner la guerre et sa poursuite permet à Charles de Gaulle de brider les forces de gauche de la Résistance intérieure, sans qu’il n’y ait jamais eu de volonté du PCF de faire un putsch. Militants et dirigeants, tel André Marty, qui y étaient favorables étaient très minoritaires. De Gaulle a les cartes en main parce que la Libération s’est d’abord faite grâce aux forces militaires alliées.
La Résistance armée a joué un grand rôle en gênant les déplacements de troupes allemandes mais il n’y a pas eu d’insurrection armée dans la France entière. L’insurrection n’a eu lieu que dans quelques villes, dont Paris. La population n’est pas mobilisée politiquement pour s’emparer du pouvoir.
Michel Pigenet, historien et auteur de les États généraux de 1945. Une expérience démocratique oubliée (éditions du Croquant).
Les Forces françaises de l’intérieur (FFI) ont conscience de leur infériorité militaire face à l’armée allemande, raison pour laquelle les Francs-tireurs et partisans (FTP) préconiseront la « goutte de mercure » insaisissable. Il faut s’entendre sur la notion d’« insurrection ». Ce qui se passe après le 6 juin 1944 en revêt bien des aspects.
Une formidable levée en masse gonfle les rangs des FFI, dont les effectifs quintuplent en quatre mois. Toute la Résistance bascule dans la lutte armée, tandis que de nouvelles autorités issues de la clandestinité se substituent aux précédents cadres politiques et administratifs…
Tout va très vite. Les contemporains disposent, certes, de repères sur les possibles et contraintes de l’heure, à l’aune desquels ils s’efforcent de percevoir les rapports de force. Les dynamiques à l’œuvre interdisent toutefois les pronostics trop précis.
Les différents acteurs identifiés par Gilles Richard tentent de consolider leurs positions et de peser sur le cours des choses, ce qui ne va pas sans tensions, que chacun veille toutefois à ne pas conduire jusqu’à la rupture. Le CNR reconnaît ainsi l’autorité du général de Gaulle, qui dirige le GPRF d’une main de fer et se garde de la moindre référence au programme commun de la Résistance.
Fort d’un prestige qu’il excelle à entretenir, le chef du gouvernement bénéficie rapidement du soutien décisif du cœur de l’appareil d’État, qui a reconnu en lui le garant d’une « restauration » rassurante. Pour autant, si la légitimité patriotique tient lieu de légitimité politique, elle ne vaut pas certificat de légitimité démocratique.
Or, ni la guerre, ni l’état du pays, ni l’absence des prisonniers et des déportés ne rendent envisageable une rapide validation électorale. Jusque-là, irresponsable devant l’Assemblée consultative, dont l’intitulé résume les limites, le GPRF, instance exécutive et législative, gouverne sans véritable contrôle.
Le CNR ne jouit, lui, d’aucune prérogative officielle, mais n’entend pas s’effacer. Résolu à tenir un rôle de tuteur moral et politique, il considère plus que jamais son programme comme étant d’actualité. À cette fin, il peut compter sur le maillage des comités de libération, qui, localement, sont à l’initiative dans l’organisation du ravitaillement, la relance économique, l’épuration, etc.
Quelle carte vont jouer les différentes composantes du CNR ?
Michel Pigenet : Le CNR, une exception dans l’Europe occupée, a été réuni par Jean Moulin pour signifier le soutien de la Résistance à de Gaulle. Sa large composition, qui laisse à l’écart l’extrême droite et le patronat, assure sa représentativité. Ses décisions ne valent qu’à l’unanimité qu’autorise son ciment patriotique.
À partir de là, les priorités et solidarités du combat clandestin facilitent la dynamique de rapprochements improbables où l’estime et la confiance ont leur place. Ainsi, c’est au communiste Pierre Villon, délégué du Front national, que celui de la très réactionnaire Fédération républicaine, Jacques Debû-Bridel, confie le mandat de la représenter au bureau restreint du Conseil.
Quant aux mouvements de Résistance, ils échappent aux critères de classement partisans, mais le volontarisme inhérent à leur rébellion initiale n’est pas étranger à la radicalité de plusieurs de leurs positions. En termes d’institutions, il s’agit moins, enfin, pour le CNR de « restaurer » la République sur le modèle de la IIIe République, discréditée par sa capitulation, que d’en instaurer une « vraie », démocratique et sociale.
Qui porte cette ambition ?
Michel Pigenet L’ambition du programme du CNR ne vient pas forcément d’où on pourrait le penser. Dans « les Jours heureux », il y a la lutte immédiate et les premières mesures à prendre après la Libération. Au moment de l’élaboration, les communistes insistent surtout sur la première partie.
Ils ne souhaitent pas rétrécir le CNR par une orientation trop marquée à gauche. Ils ont tendance à rétrécir la partie programme alors que socialistes et syndicalistes poussent des réformes de structure, des nationalisations et la planification.
Comment expliquer cette priorité à la lutte armée ?
Michel Pigenet Cette priorité procède d’une approche globale du conflit et de la solidarité avec l’URSS. Tout ce qui nuit à l’effort de guerre de l’occupant et entretient l’insécurité de ses troupes à l’Ouest soulage l’Armée rouge à l’Est.
Gilles Richard Si les communistes insistent tant sur la Libération par le soulèvement national, c’est aussi pour asseoir la légitimité de la Résistance intérieure. L’insurrection populaire devait permettre de faire contrepoids à de Gaulle et à l’armée.
Quel rôle joue la CGT ?
David Chaurand, directeur de l’Institut CGT d’histoire sociale.
La présence de la CGT et la CFTC au sein du CNR est importante. Alors que les tensions étaient fortes avant-guerre entre unitaires et confédérés, les deux composantes de la CGT se réunifient en avril 1943. Cela a été la première étape vers la création du CNR. La CGT y est représentée par Louis Saillant, qui en sera d’ailleurs le dernier président. Elle joue un grand rôle dans l’élaboration du programme.
La CGT sort de la guerre avec une légitimité renforcée. Elle n’a jamais été aussi forte, sans doute davantage qu’elle ne l’a été en 1936. Dans ses rangs, plusieurs millions d’adhérents. La CGT est désormais un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics dans le cadre de la reconstruction. Elle est présente au gouvernement à travers les ministres communistes comme Marcel Paul ou Ambroise Croizat, qui sont aussi des dirigeants de la CGT.
Michel Pigenet Des centaines de cégétistes participent, en outre, à la gestion de la Sécurité sociale, confiée aux deux tiers à des administrateurs salariés, proportion portée aux trois quarts par Ambroise Croizat. D’autres figurent dans les conseils d’administration tripartites des entreprises nationalisées. Partie prenante des 25 commissions du plan, la CGT en préside 4.
Que se passe-t-il dans les entreprises ?
David Chaurand : L’effervescence de la Libération touche aussi les entreprises. La CGT va tenir une place importante dans les comités patriotiques et d’épuration qui se forment dans de nombreuses entreprises. Les travailleurs sont à l’initiative de multiples façons. On pense d’emblée aux comités de gestion, qui associaient donc les travailleurs à la gestion de l’entreprise. Robert Mencherini a mis en évidence ces expériences à Marseille, Rolande Trempé à Toulouse, sans oublier ce qui se passe à Montluçon ou à Lyon. Antoine Prost les chiffre à une centaine mais c’est peut-être sous-estimé.
Mais l’intervention des travailleurs ne doit pas être limitée aux comités de gestion. Les usines sont confrontées à une diversité de problèmes qui vont des difficultés d’approvisionnement aux défaillances administratives et qui obligent les travailleurs à s’impliquer dans leur remise en marche et à prendre des initiatives. C’est un sujet qui mérite d’être mieux étudié, ce que nous avons d’ailleurs commencé à entreprendre à l’IHS CGT.
Gilles Richard : L’ampleur des problèmes de ravitaillement est telle qu’en juin 1943, le ministre de Vichy qui en a la charge affirme que la France connaît une situation de « famine lente ». Or, la situation s’aggrave dans les années suivantes. Depuis le XVIIIe siècle, jamais la population n’avait connu un tel recul du niveau de vie.
David Chaurand : L’intervention des travailleurs est aussi patriotique que vitale pour eux et leur outil de travail. Elle est spontanée et ne semble pas relever d’une stratégie quelconque. Ces prises d’initiatives, quelles que soient leurs formes, sont importantes car elles modifient le rapport de force dans les entreprises. Les comités de gestion sont souvent mis en place dans les entreprises où le pouvoir est vacant.
Accusés de collaboration, les patrons ont fui ou ont été emprisonnés. C’est le cas de Berliet à Lyon, par exemple. La prise de pouvoir se fait différemment d’une région à une autre. À Toulouse, elle est plus négociée tandis qu’à Marseille ou Montluçon, les travailleurs s’imposent au point qu’est dénoncée « une soviétisation ». Le patronat a très peur de ce qui se passe et utilisera notamment l’arme juridique pour se défendre.
Michel Pigenet : La Libération précipite, dans maintes entreprises, un renversement du rapport des forces sociopolitiques. Au service de l’occupant et avec la complicité de larges fractions du patronat, Vichy a paupérisé le gros des salariés, allant jusqu’à leur imposer un service de travail obligatoire en Allemagne.
Si la révolution n’est pas à l’ordre du jour ouvrier de 1944-1945, les règlements de comptes de la période ont à voir avec la lutte des classes. Ici et là, des employeurs de combat sont exécutés. D’autres, plus prudents, s’éclipsent, tandis que la plupart font le dos rond. Un peu partout, sur fond de pénurie de matières premières et de pièces, les syndicats relèvent le défi et sont à l’initiative.
Il s’agit d’abord de relancer la production, de garantir l’emploi et les salaires. Avec ou sans le concours des patrons, de préférence avec celui des cadres. Mais ce qui est en jeu, c’est aussi la capacité ouvrière d’intervenir sur le terrain inédit de la gestion et, chemin faisant, d’empiéter sur les prérogatives patronales.
Exemple parmi des centaines d’autres, chez Ford, à Poissy, les cégétistes se procurent les pièces nécessaires à la bonne marche de l’usine et, simultanément, exigent un droit de regard sur la désignation des contremaîtres. Au jour le jour, un syndicalisme de réalisation et de transformation sociale s’affirme aux quatre coins du pays à travers des milliers d’expériences dont nous n’avons qu’une connaissance partielle.
Les états généraux de la renaissance s’inscrivent-ils dans cette dynamique ?
Michel Pigenet Entre le moment où l’idée prend forme, en septembre 1944, et la réunion, à Paris, du 10 au 13 juillet 1945 de leurs 2 000 délégués nationaux, les états généraux ont atteint l’objectif d’une appropriation dynamique du programme du CNR, leur initiateur.
Substitut à l’absence d’élections générales, la procédure, inspirée de 1789, participe d’une remarquable expérience de « démocratie agissante » qu’illustre la rédaction, à l’échelle des communes, de milliers de cahiers de doléances. Ceux-ci saisissent les aspirations et les certitudes de l’époque. Ils confirment l’adhésion massive à de substantiels progrès sociaux, éducatifs et culturels, que tempère une certaine frilosité sociétale et coloniale.
Gilles Richard Les états généraux s’inscrivent aussi dans cette période où s’affrontent les partisans d’un nouveau Front populaire et leurs adversaires, qui se rangent derrière de Gaulle. Ils sont une manière, d’abord pour le PCF, de reprendre une partie de la légitimité politique que de Gaulle a construite depuis 1940.
Comment se déroulent les élections à la Constituante ?
Gilles Richard La grande nouveauté, c’est le droit de vote des femmes, qui fait plus que doubler la taille du corps électoral. C’est l’aboutissement des combats féministes depuis cent cinquante ans. Dans les colonies, le droit de vote est aussi accordé à une fraction des colonisés. Jusque-là, seuls les Français installés dans les colonies votaient.
Les gauches en sortent majoritaires avec un avantage de près de 3 % pour le PCF sur la SFIO. Cette majorité socialo-communiste est une première et ne s’est reproduite qu’une seule fois, en 1981. Cette victoire des gauches provoque rapidement un conflit avec de Gaulle sur la nature de la Constitution à adopter et provoque son départ. Elle ouvre en même temps une période où de grandes lois économiques et sociales sont adoptées, jetant les bases de ce que Jaurès appelait « la République sociale ».