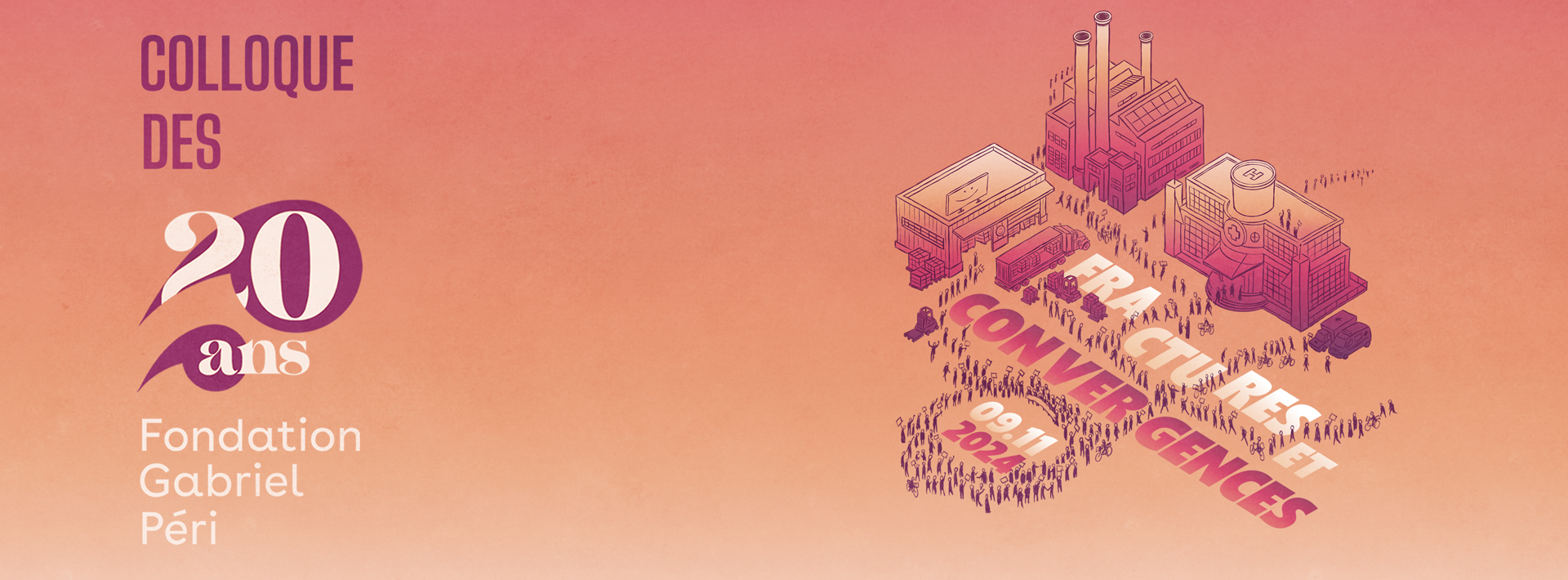Restitution par Pierre-Henri Lab dans la rubrique « En débat » de l’Humanité de la troisième table ronde du colloque « Milieux populaires et monde du travail: Fractures et convergences ».
L’Humanité, le 30 janvier 2025.
Lire sur le site du journal
Le 9 novembre 2024, à l’occasion de ses 20 ans, la Fondation Gabriel-Péri a organisé au siège du PCF un colloque sur les effets des transformations du capitalisme sur le monde du travail. À cette occasion, syndicalistes et militants communistes se sont interrogés sur comment construire une nouvelle conscience de classe. Cette rencontre était animée par Stéphane Bonnéry, directeur de la revue La Pensée.
Quels obstacles les salariés rencontrent-ils pour se mobiliser en tant que classe ?

Marie-Claire Cailletaud
Syndicaliste et membre honoraire du Conseil économique, social et environnemental (Cese)
L’idéologie du management théorise la mise en concurrence permanente des salariés entre eux. La désintégration des entreprises, le développement de la sous-traitance, la remise en cause des statuts des salariés ou la précarité déstabilisent les collectifs de travailleurs. Si on entend, comme le sociologue Olivier Schwartz, par classe ouvrière un groupe cohérent d’ouvriers mobilisés ayant ce qu’on appelait autrefois une certaine conscience de classe, revendiquant une certaine identité ouvrière et dotés d’organisations qui les représentent, alors il faut constater que, depuis quinze ou vingt ans, on assiste à sa déconstruction.
L’une des causes réside dans la liquidation de pans entiers de l’industrie lourde et de ses gros bataillons ouvriers : les mines, la métallurgie, la sidérurgie. Les transformations du système productif ont cassé les solidarités, affaibli les organisations syndicales et dépolitisé le monde du travail. La disparition des classes sociales a été théorisée avec l’idée qu’elles seraient remplacées par des catégories différentes : les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes… Pourtant, un jeune livreur a plus d’intérêts communs avec un salarié de l’automobile qu’avec un jeune héritier du CAC 40, et une femme de ménage avec un ouvrier d’usine qu’avec l’épouse d’un banquier.
Comment construire une nouvelle conscience de classe ?
Souvent, les travailleurs et les syndicats sont placés le dos au mur par une direction qui leur explique que, s’ils n’acceptent pas une baisse de leurs salaires, l’entreprise mettra la clé sous la porte. Sous couvert de non-rentabilité, il s’agit en fait d’accroître les dividendes. Il faut montrer que les politiques menées relèvent de choix et que, par conséquent, d’autres choix sont possibles. S’emparer des enjeux économiques en faisant valoir une vision différente de l’économie que celle de l’idéologie dominante est le défi que doit relever le syndicalisme.
Il faut donc dénoncer la violence symbolique de la classe dominante qui fait passer pour légitimes et universels ses intérêts propres. Dévoiler et contester, c’est repolitiser. Il faut ainsi construire des propositions alternatives fortes et unifiantes. Discuter collectivement de son travail dans l’entreprise permet de construire la lutte. Le travail par filière permet d’élaborer des revendications communes et de construire ainsi des solidarités entre les salariés des sous-traitants et ceux des donneurs d’ordres. Revendiquer un nouveau statut protecteur des travailleurs dans une sécurité sociale professionnelle du même niveau que la Sécurité sociale contribuerait aussi à l’unité du monde du travail.
Mais comment construire un rapport de force suffisant ?
Il ne s’agit pas simplement de multiplier les luttes mais faire en sorte qu’elles se matérialisent dans des formes structurées de représentation telles que des délégués, des organisations syndicales ou politiques. L’État ne peut plus être le seul lieu de contestation du capitalisme. Un mouvement de revendication de nouveaux droits à partir de l’entreprise devient indispensable, ainsi qu’un système de pouvoirs permettant de les faire respecter. Le mouvement syndical doit redéfinir son rapport au politique. Dans le rapport de force qu’il faut établir, personne n’est de trop. Chacun a un rôle à jouer dans le respect de son indépendance et sans hégémonie. Syndicats et partis pourraient se doter de lieux d’échanges pour mettre leurs forces au service de propositions communes.
Comment, Manon Ovion, la grève s’est-elle déclenchée chez Vertbaudet ?

Manon Ovion
Déléguée syndicale CGT chez Vertbaudet
Nous sommes presque toutes ouvrières avec les mêmes difficultés en termes de conditions de travail ou de salaires. Nous en avions tous marre d’être payés des broutilles. Nous étions payés au Smic, quelle que soit notre ancienneté. La grève a éclaté en mars 2023. La CGT venait de s’implanter. Lors des négociations annuelles obligatoires, nous avons été abasourdis de voir les autres syndicats négocier des choses à titre personnel. Nous avons demandé à chaque salarié combien il lui manquait pour finir le mois décemment. En moyenne, c’était 300 euros. Lors de la réunion, nous avons déposé les réponses des salariés sur le bureau du DRH en lui disant : « Voilà ce que demandent les salariés. » Nous n’avons pas été entendus. Les autres syndicats ont signé un accord sans augmentation. C’était impensable d’en rester là alors que Vertbaudet tourne très bien.
Avec l’union locale CGT de Tourcoing, nous avons profité de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le 20 mars, à 4 heures du matin, nous avons bloqué les accès de l’entreprise afin de demander aux collègues si ce n’était pas le moment de montrer notre ras-le-bol de travailler pour rien. Ils ont suivi. La police est venue lever le blocage, mais les salariés ont refusé de rentrer dans l’entreprise. Chez Vertbaudet, on n’avait jamais fait grève. Nous étions très fiers. Le lendemain, l’assemblée générale a reconduit la grève à notre grande surprise. Elle l’a fait chaque jour pendant quatre-vingt-quatre jours. Nous avons reconstruit la solidarité entre nous.
Nous avons aussi reçu le soutien de partout, de la CGT, des partis de gauche. Cela nous a permis de tenir. Quatre-vingt-quatre jours de grève, ce n’est pas facile. Il fallait organiser le mouvement sans trop impacter la vie des ouvriers, en majorité des femmes dont de nombreuses mères isolées. Le piquet de grève a été tenu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les hommes l’ont tenu la nuit afin que les femmes conservent leurs horaires postés afin de limiter les effets sur leur vie.
Vous avez aussi subi des violences…
Un jour sur deux, les CRS venaient nous déloger. Sur 100 grévistes, nous étions une trentaine à être présents en même temps sur le piquet et on voyait débouler une vingtaine de camions de CRS. Ils cassaient tous. Des salariés ont été maltraités physiquement. Une collègue qui sortait d’un traitement contre le cancer a été traînée par terre et saisie à la gorge. Beaucoup ont été choqués. Nous ne faisions rien de mal. Nous nous sommes rendu vite compte que nous dérangions la société.
Sur un piquet de grève, on ne fait rien, on attend. On sait que la direction n’en a rien à faire de nous. On le voit tous les jours au travail, mais on s’en rend compte encore plus sur le piquet. Mettre autant de moyens policiers contre des femmes, des mères, des grands-mères, c’est révoltant. Quand on a commencé la grève, nous étions en colère. À la fin, nous éprouvions de la haine. Les collègues sont devenues des guerrières. Plus jamais, elles ne feront de cadeaux à la direction.
Pourquoi vous êtes-vous engagée sur la liste du PCF aux européennes ?
Cela s’est fait dans la continuité de la grève. Darmanin est maire de Tourcoing. Vertbaudet appartient au fonds de pension Equistone, dont l’un des actionnaires est Gabriel Fillon, le fils de François Fillon. Ils n’ont pas cessé de tenter de casser la grève. La grève a tellement été politisée du côté capitaliste qu’il nous fallait un relais pour faire pencher dans notre sens. Sans la politique, nous n’aurions pas gagné. Avant ça, je n’étais pas du tout politique.
Comment, Caroline Blanchot, l’Ugict-CGT construit-elle du commun entre salariés ?

Caroline Blanchot
Secrétaire générale de l’Ugict-CGT
La CGT est la seule organisation syndicale de classe et de masse qui intègre les ingénieurs, cadres et techniciens. L’Ugict n’est pas un groupe de réflexion, elle fait en sorte qu’ils élaborent leurs propres revendications en convergence avec leurs collègues, ouvriers et employés. Tous les salariés subissent le capitalisme, mais cela se matérialise différemment suivant le lieu de travail, l’activité ou les catégories de salariés.
On parvient à mobiliser les salariés à partir de ce qu’ils vivent. L’exercice professionnel a une importance cruciale pour les cadres. La façon dont on produit, la pratique du métier, est un élément mobilisateur. Le salaire n’est pas le premier sujet de mobilisation. La CGT a commencé à organiser les ingénieurs, cadre et techniciens dans les années 1930 alors qu’ils ne représentaient que 3 % des travailleurs. Après 1936, avec les conventions collectives, ont commencé à être élaborés grades et classifications afin de reconnaître les diplômes, la pratique professionnelle et d’empêcher l’arbitraire patronal dans la définition des hiérarchies.
Et aujourd’hui ?
À l’heure actuelle, de plus en plus de conventions collectives s’affranchissent de ces systèmes. Les directions ne distinguent plus que cadres et non-cadres. La confusion entre les catégories de salariés et ces blocs contribue à marginaliser un peu plus les cadres. Vous êtes cadre ou non-cadre, vous n’êtes plus reconnu comme ouvrier, employé, technicien ou ingénieur. À la CGT, nous essayons de déconstruire cette confusion pour mieux organiser ces catégories qui souffrent y compris sur le plan de la rémunération car la déqualification entraîne une baisse du salaire. Entre 1997 et 2015, le salaire à l’embauche à bac + 3 a baissé de 40 euros par mois.
À bac + 5, la perte est de 200 euros mensuels. Dans les années 1990, un cadre gagnait en moyenne 4,5 Smic par mois. Aujourd’hui, c’est 1,8 Smic, soit une perte mensuelle de 1 820 euros constants. Un technicien qui gagnait 2,4 Smic par mois ne gagne plus que 1,8 Smic, soit une perte de 800 euros constants. Cette dévalorisation ne se traduit pas dans les luttes car elle s’est produite de façon progressive. À raison, nous avons syndicalement tendance à nous concentrer sur le problème des bas salaires mais, faute de considérer l’ensemble de la grille des salaires, nous peinons à mobiliser tous les salariés.
Les cadres perçoivent-ils la dégradation de leurs conditions comme une réalité partagée avec les autres catégories ?
Les cadres ont conscience de ce qu’ils vivent. Cela les pousse à se syndiquer. Près de 120 000 sont syndiqués à la CGT. L’an dernier, 10 000 ont adhéré. La question posée est celle de la place qu’on leur accorde dans l’organisation.
Comment le PCF fait face à la question de la construction d’une conscience de classe ?

Frédéric Mellier
Conseiller régional PCF de Nouvelle-Aquitaine, auteur de Blocs politiques ou unité du salariat
Il faut avoir en tête que, quand Marx et Engels publient le Manifeste du Parti communiste, les ouvriers sont très minoritaires parmi les travailleurs. Depuis, le salariat s’est généralisé et représente 90 % de la population active. La deuxième évolution à prendre en compte est celle de sa composition partagée désormais en quatre catégories quasi équivalentes : ouvriers, employés, les professions intermédiaires et les cadres et ingénieurs.
Unir le salariat et construire une nouvelle conscience de classe implique également de considérer la crise du capitalisme et ses effets comme la grande souffrance des salariés due en particulier à la perte de sens au travail. Cette crise est intervenue alors que la gauche tournait le dos au monde du travail. Ces gouvernements ont contribué à détricoter les conquis sociaux. Le PCF n’a pas su faire face. L’un des enjeux du 38e congrès a été de réorienter l’action des communistes en direction des entreprises et à structurer une activité communiste à l’intérieur de celles-ci.
La lutte des ouvrières de Vertbaudet est devenue un symbole. Il existe de nombreuses luttes moins connues. Comment la prise de conscience qui s’opère dans ces conflits peut-elle se transformer en conscience politique ?
Il faut contester le pouvoir patronal et actionnarial tant en termes de répartition des richesses que d’organisation du travail et de sa finalité. Les communistes doivent aussi débattre avec les salariés de leurs propositions comme la sécurité d’emploi ou de formation ou la création de nouveaux pouvoirs d’intervention et de gestion des salariés. Nous portons aussi une parole de défense de la dignité de celles et ceux qui travaillent. Depuis septembre, le PCF mène deux campagnes de long terme sur les services publics et sur l’industrie. Nous voulons combattre les politiques d’austérité à partir des besoins tels qu’ils s’expriment.
Cette campagne vise à créer des jonctions entre agents, usagers et élus et à favoriser la démocratisation de la gestion des services publics par leur participation. En matière d’industrie, il s’agit d’élaborer une politique capable de satisfaire les besoins de la population tout en faisant face aux enjeux écologiques. Là encore, nous voulons impliquer ensemble les salariés et la population. Nous voulons être en dialogue avec les organisations syndicales. L’exemple de Vertbaudet est significatif. Organisations politiques et organisations syndicales doivent travailler ensemble afin d’alimenter mutuellement leurs réflexions mais aussi construire des mobilisations.
Comment nommer la classe ?
Frédéric Mellier: Le salariat est la base sociale sur laquelle nous devons rassembler. Les termes de classe travailleuse traduisent le mieux cette réalité sociale.
Caroline Blanchot: Les mots travailleur et travailleuse permettent une identification de tous les salariés. La classe travailleuse est celle de ceux qui sont obligés de travailler pour vivre.
Marie-Claire Cailletaud La classe se définit par les intérêts communs. Ceux qui travaillent ont des intérêts communs. Pour rassembler les salariés, il faut partir de la question du travail. Contrairement à ce que certains à gauche ont affirmé, le travail émancipe.