Par Jean-Numa Ducange
Historien, auteur de Quand la gauche pensait la nation. Socialisme et nationalité à la Belle époque, (Fayard, 2021).
De Berlin à Moscou jusqu’à Shanghaï, la Commune est autant célébrée qu’elle donne lieu à de multiples controverses et interprétations qui traversent le mouvement ouvrier à partir des années 1880. Inspirés par cette expérience politique inédite brutalement interrompue, Engels, Marx, les socialistes allemands et français, Lénine et bien d’autres en tirent des enseignements essentiels. Jean-Numa Ducange nous immerge dans ces débats foisonnants touchant des questions politiques majeures pour tout projet transformateur, qui sont loin d’être épuisées.
Une version courte de cet article paraît dans L’Humanité du 19 mars 2021.

L’Humanité, 18 mars 1908 (Gallica). Hommage anglais, d’après un dessin de W. Crane.
Une des grandes questions qui se pose aux courants socialistes à la fin du XIXème siècle pourrait se résumer ainsi : que faire de la Commune ? Écrasée en mai 1871, sa mémoire est investie par de nombreux socialistes et anarchistes qui voit en elle une expérience politique unique. Elle s’achève certes sur un terrible échec ; mais les Communards exécutés sont célébrés comme des martyrs tombés au combat. En France, bien sûr, où les survivants de la Commune (Louise Michel, Benoit Malon, Édouard Vaillant…) ou leurs soutiens en régions (tel Jules Guesde, qui était à Montpellier au moment des événements) vont jouer un rôle important dans la construction des divers courants socialistes. Mais aussi parmi de nombreux groupes militants dans toute l’Europe : ainsi le 18 mars est l’occasion de rappels chaque année des actions glorieuses des Communards. La date est célébrée par de nombreuses sections socialistes. De Berlin à Moscou, de Londres à Budapest et même bientôt à Tokyo et Shanghai, la « Commune », c’est celle de Paris, des héroïques Communards tombés au combat[1].
En Allemagne, où la social-démocratie allemande devient, à partir des années 1880, le parti ouvrier le plus implanté du continent, la date est commémorée chaque année avec faste. Il faut dire qu’à Berlin la Commune a une signification particulière. Comme on le sait, l’histoire de la Commune est indissociable de la guerre franco-allemande. Le patriotisme de la plupart des Communards ne fait pas de doute en 1871, les revendications de défense du pays et de la ville se mêlèrent aux aspirations sociales. Cela rend d’autant plus héroïque les quelques manifestations de solidarité organisées par Wilhelm Liebknecht et August Bebel, les deux pères fondateurs de la social-démocratie allemande.
Qui plus est la date du 18 mars évoque le Paris de 1871 mais aussi – heureux hasard du calendrier – les barricades de Berlin en 1848. Le 18 mars permet donc de célébrer la continuité révolutionnaire entre les deux pays. Bien sûr, les deux expériences se sont achevées par la victoire des forces contre-révolutionnaires. Mais elles dessinent un chemin pour l’avenir, les bases d’une société nouvelle. À une époque où les classes dominantes française comme allemande cultivent un chauvinisme sans détour, la célébration de ce 18 mars franco-allemand résonne encore comme une des premières tentatives historiques de faire vivre concrètement l’internationalisme. Car il ne s’agit pas que de théorie : en 1898, pour les cinquante ans de 1848, le gigantesque défilé qu’organisent les social-démocratie allemande et autrichienne à Berlin, Vienne (et dans de très nombreuses autres villes industrielles) honorent aussi l’expérience française, montrant l’importance de l’attachement de nombreux militants à cette date du 18 mars.
Critiquer la Commune ?
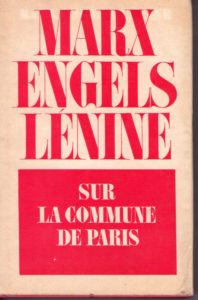
Marx, Engels, Lénine, Sur la Commune de Paris, recueil, Moscou, Éditions du progrès, 1971.
On aurait pourtant tort de comprendre ces manifestations comme un appel pur et simple à dresser des barricades comme en 1871. Certes, Marx a salué dans la Commune une expérience politique de type nouveau dans La guerre civile en France ; sa solidarité était d’autant plus forte que la répression venait de s’abattre impitoyablement (Marx écrit en effet son texte juste après la fin de l’insurrection[2]). Mais une fois les braises refroidies, et malgré les apports incontestables des Communards, Marx et Engels n’hésitent à se montrer critiques à l’égard des méthodes employées. Friedrich Engels, le 14 janvier 1872, écrit par exemple à Carlo Terzaghi que « ce fut le manque de centralisation et d’autorité qui coûta vie à la Commune de Paris (…) et quand on me parle de l’autorité et de la centralisation comme de deux choses condamnables en toutes circonstances, il me semble que ceux qui le disent soit ignorent ce qu’est une révolution, soit ne sont des révolutionnaires qu’en paroles[3] ». À rebours sur ce point des aspects les plus décentralisateurs de certains passages de La guerre civile en France, Engels affirme que sans une forme d’autorité centrale, toute révolution politique est condamnée.
Quelques années plus tard Marx lui-même procède à un examen critique de l’expérience. Le 22 février 1881, il écrit au néerlandais Ferdinand Domela Nieuwenhuis : « sans compter que ce fut l’insurrection d’une seule ville dans des conditions exceptionnelles, la majorité de la Commune n’était nullement socialiste et ne pouvait l’être. Avec un minimum de bon sens elle aurait pourtant pu obtenir un compromis avec Versailles, qui profitât à toute la masse du peuple : l’unique chose à faire alors. La prise de la Banque de France eût suffit à intimider les hâbleurs de Versailles, etc. etc.[4] ».
Quelques années plus tard, Engels affirme encore plus brutalement le 29 octobre 1884 à Bebel : « la Commune fut à la fois la tombe du vieux socialisme, spécifiquement français, et le berceau du nouveau communisme international ». Pourtant dans d’autres textes, la Commune est bien toujours prise comme exemple. Dans une préface de 1891, Engels conclut que la Commune est une expérience de « dictature du prolétariat », c’est-à-dire une dictature de la majorité contre une minorité d’exploiteurs… Célébrer la Commune, sans aucun doute. Mais est-ce un modèle ? Doit-on la dépasser ? Voilà tout l’enjeu.
Dix ans après la préface d’Engels, mort en 1895, Charles Longuet (gendre de Marx marié à sa fille Jenny), publie en 1901 une nouvelle édition du texte de Marx. Le titre a changé, et il est significatif : La Commune de Paris. Pour Longuet, il s’agit clairement d’éviter le titre de « guerre civile » au profit d’une perspective gradualiste dans le mouvement socialiste. À cette date en effet, une frange importante de plusieurs partis socialistes remet en cause la voie révolutionnaire, que beaucoup défendaient jusqu’alors. Le plus éminent représentant de ce courant est l’allemand Eduard Bernstein qui fustige, dans Les présupposés du socialisme (1899), la popularité de la tradition « blanquiste » (du nom de Blanqui, dont nombre de Communards étaient proches). Il vise l’héritage révolutionnaire français, de 1793 à 1871. Il faut en finir selon lui avec un certain esprit insurrectionnel qui nuirait au développement du socialisme organisé.
Comment expliquer une telle évolution ? Il faut tout d’abord souligner que de larges franges du mouvement ouvrier refusent une telle perspective. De Jules Guesde à Rosa Luxemburg, des courants demeurent opposés à la perspective de Bernstein. Mais assurément, depuis 1871, le contexte politique a beaucoup changé. Au tournant des XIXe et XXe siècles, le mouvement ouvrier s’est doté de partis, d’organisations syndicales et coopératives. Le suffrage universel masculin est pratiqué dans plusieurs pays européens. Ne peut-on pas conquérir le pouvoir autrement, par la voie légale ?

L’Humanité du 18 mars 1907 (Gallica)
Jean Jaurès par exemple (un des principaux fondateurs du Parti socialiste unifié en 1905) célèbre sans ambiguïtés les mérites de la Commune, notamment ses mesures sociales et politiques. Mais à l’occasion de l’anniversaire des événements, le 18 mars 1907, dans L’Humanité (« Hier et demain ») il affirme ainsi que « même si elle avait été victorieuse, la Commune de Paris n’aurait pu transformer dans son fond la société ». Selon le tribun socialiste, « la victoire de la Commune aurait peut-être avancé de dix ans l’évolution de la Troisième République ; elle n’aurait pas fait surgir du sol le socialisme ». Jaurès souligne qu’il faut désormais tenir compte de deux réalités majeures : le suffrage universel (qui permet au parti socialiste de conquérir des positions) et la grève générale (un des principaux moyens d’actions de la CGT, qui permet une action coordonnée et offensive du prolétariat, à distance de l’insurrection désespérée). Bref il faut saluer « l’effort héroïque » des Communards. Mais selon Jaurès il est nécessaire de trouver d’autres chemins.
Certains anciens communards eux-mêmes, à l’image de Benoit Malon, sont même à l’origine du réformisme politique. Ainsi dix ans après les événements, en 1881, Malon mobilise la référence à la Commune, mais dans une optique de valoriser la politique concrète à l’échelle d’une municipalité : « ainsi envisagée la question communale est plus de la moitié de la question sociale[5] ». Et à sa suite tout un courant du socialisme, jusqu’à Albert Thomas (futur ministre de l’armement pendant la Première Guerre mondiale), place ces espoirs dans une telle perspective, que l’on appelle le « municipalisme[6] ». Avec eux se dessine un « socialisme réformateur », où naît notamment l’idée d’un service public républicain. Ils font plutôt le deuil de la Commune insurgée et ne retiennent de l’expérience que quelques mesures concrètes, vidant de sa substance subversive l’expérience communarde.
S’inspirer de la Commune pour la dépasser ?
Au-delà des divergences entre courants socialistes, tous s’accordent plus ou moins sur le fait que l’organisation doit permettre de dépasser les insuffisances de la Commune.
Ce fait n’est pas à prendre à la légère. En effet, le succès de la forme parti à la fin du XIXème siècle, s’il doit être compris dans un contexte plus large, doit beaucoup aux leçons tirées de la Commune. Honneur à elle, certes, d’avoir montré la voie. Mais il est urgent d’aller plus loin et autrement, au risque de nouvelles défaites. Rien ne dit que certains courants socialistes – que l’on pense au courant fondé par Guesde en France, ou aux bolcheviks en Russie – n’auraient théorisé et/ou pratiqué des formes d’organisations aussi structurées et hiérarchisées sans le traumatisme de 1871.

Affiche de Vladimir Kozlinski, fenêtre Rosta, « Les Morts de la Commune de Paris ont ressuscité sous le drapeau rouge des soviets », reprise en Une du Bulletin des Amis de la Commune (2017).
Ainsi le bolchévisme n’aurait probablement pas existé sous la forme que l’on lui a connue sans l’expérience communarde. En effet, si dès les années 1880 d’aucuns retiennent de la Commune qu’il faut désormais éviter toute rupture violente, d’autres au contraire insistent sur la nécessaire conquête de l’appareil d’État pour le retourner contre les ennemis de la révolution. L’exemple de la Commune façonne ainsi l’identité de l’aile gauche du socialisme international. Lénine admire intensément l’audace des Communards. Mais il souhaite désormais que la « dictature du prolétariat » (déjà évoquée par Marx et Engels) à venir se donne les moyens de sa politique… Au risque de nouvelles semaines sanglantes au cours desquelles le prolétariat serait de nouveau vaincu. Critique sur la méthode, Lénine puise néanmoins aussi dans l’expérience même de la Commune pour définir la « démocratie prolétarienne » dans l’État et la révolution, rédigé en 1917, quelques mois avant l’insurrection d’octobre. De Marx, il reprend l’idée de « briser l’État » pour lutter contre le « bureaucratisme » :
« Apprenons donc des communards l’audace révolutionnaire, tâchons de voir dans leurs mesures pratiques une esquisse des mesures pratiquement urgentes et immédiatement réalisables ; c’est ainsi que nous parviendrons, en suivant cette voie, à détruire complètement le bureaucratisme ».
Lorsque le pouvoir soviétique aura tenu un jour de plus que la Commune, Lénine estimera avoir franchi un pas historique décisif ! L’expérience est abondamment commentée et étudiée dans la jeune Russie soviétique : la Commune n’a-t-elle pas montré la voie, malgré ses limites, sur de nombreux sujets ? La question de la « démocratie prolétarienne », du contrôle ouvrier, les progrès de l’éducation comme la lutte contre l’obscurantisme religieux sont autant de thématiques mises en avant par la Commune et reprises par le jeune mouvement communiste. Depuis lors, la Commune sera d’autant plus commémorée qu’elle apparaîtra à des générations de militants de toutes tendances comme l’annonciatrice des temps nouveaux. Il reste à savoir aujourd’hui ce qui demeure inspirant… Ou à l’inverse ce qui peut sembler désormais en décalage avec nos réalités contemporaines. En ce sens, les débats stratégiques amorcés par Jaurès et Lénine sur la Commune se poursuivent (à propos de l’État, du changement social et politique…) et complètent les remarques et intuitions des témoins et acteurs de l’époque.
La tendance actuelle est aujourd’hui au retour de la Commune en elle-même et pour elle-même en tant qu’expérience propre. L’approche est légitime et permet de mieux comprendre au plus près des acteurs les motivations des Communards et de ses acteurs. Mais on aurait tort de se priver des multiples controverses et interprétations ayant traversé le mouvement ouvrier à partir des années 1880. Ces débats foisonnants abordent en effet des questions politiques majeures pour tout projet transformateur, qui sont loin d’être épuisées.
Ce texte est publié en anglais dans le magazine Jacobin et en chinois pour Foreign Theoretical Trend.
[1] Sur la postérité de la Commune voir Georges Haupt, « La Commune comme symbole et comme exemple » (L’historien et le mouvement social, Paris, Maspero, 1980) ; E. Jelouboskaïa (dir.), La Commune de Paris de 1871, Moscou, Éditions du Progrès, 1971. Eric Fournier, La Commune n’est pas morte. Les usages politiques du passé, de 1871 à nos jours, Montreuil, Libertalia, 2013. Marc César et Laure Godineau (dir.), La Commune de 1871. Une relecture, Paris, Créaphis, 2019.
[2] Voir la récente réédition des textes de Marx et Engels aux Éditions sociales (2021). Voir également le recueil Marx, Engels, Lénine, Sur la Commune de Paris, Moscou, Éditions du progrès, 1971.
[3] Ibid., p. 290.
[4] Ibid., p. 291-292.
[5] Benoit Malon, Le nouveau parti, Paris, 1881, p. 95.
[6] Patrizia Dogliani, Le socialisme municipal en France et en Europe de la Commune à la Grande Guerre, Nancy, Arbre Bleu, 2018.




